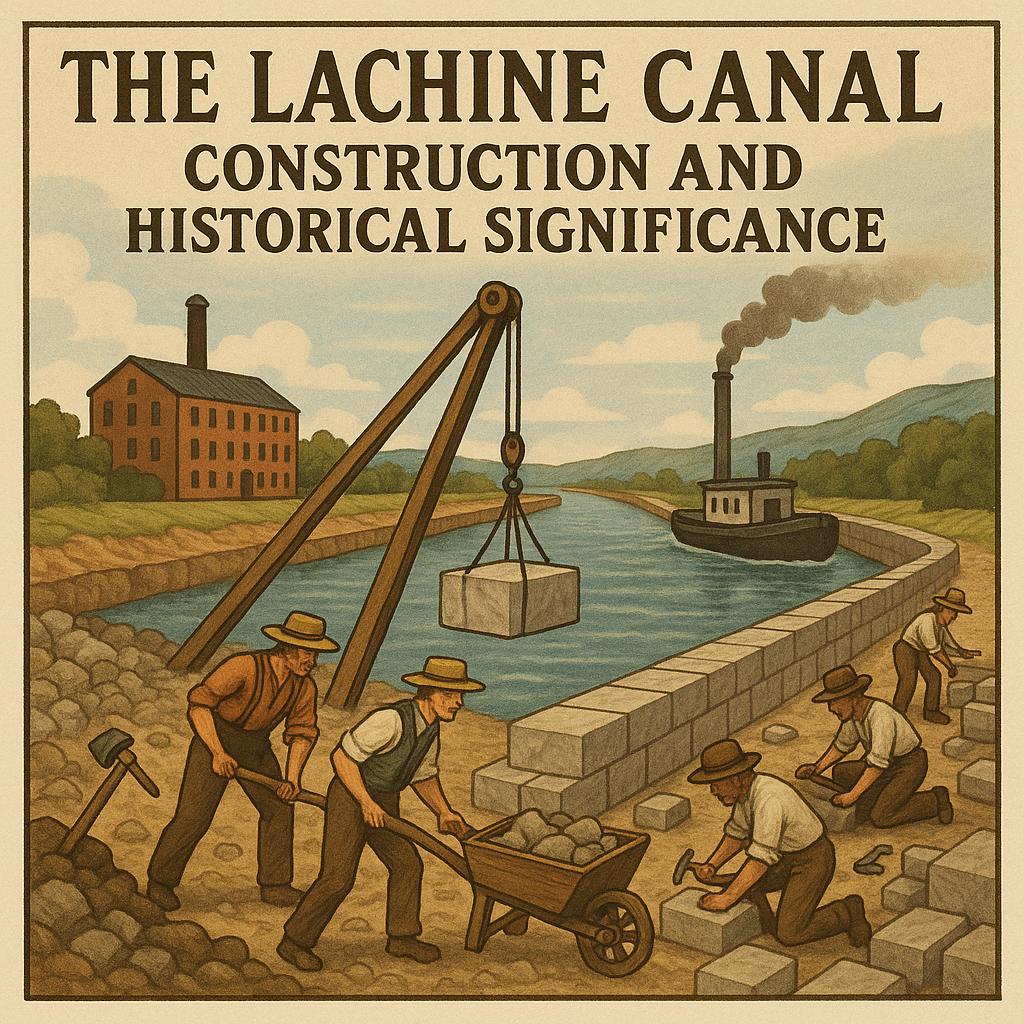
Canal de Lachine : Histoire de l'ingénierie des voies navigables canadiennes
Le canal de Lachine : Construction et importance historique
Contexte historique et premiers plans
Le canal de Lachine a été conçu pour résoudre un goulot d'étranglement critique en matière de transport dans le Canada colonial. Les rapides de Lachine du fleuve Saint-Laurent, juste en amont de Montréal, empêchaient les navires de voyager plus loin à l'intérieur des terres, forçant les marchandises à être déchargées et portées autour des rapides[1]. Dès le XVIIe siècle, les autorités coloniales ont reconnu la nécessité de contourner ces rapides. En 1689, François Dollier de Casson de l'Ordre des Sulpiciens a initié la première tentative de creusement d'un canal à Lachine, visant à amener l'eau aux moulins à grain voisins et à ouvrir une route vers l'ouest[2][3]. Ce premier projet français a été abandonné vers 1700, après qu'une attaque iroquoise et un manque de ressources aient interrompu la construction[4][3]. Pendant plus d'un siècle, l'idée d'un canal est restée en sommeil en raison de conflits persistants et d'un capital limité, mais la vision d'une route vers l'intérieur, appelée « Chine » (Lachine), a persisté dans le nom et l'imagination[5][1].
Au début du XIXe siècle, des changements géopolitiques et économiques ont relancé le projet de canal. Après la guerre de 1812, les autorités britanniques et les marchands locaux de Montréal se sont de plus en plus préoccupés de sécuriser des routes de transport non vulnérables à l'ingérence américaine[6]. Au même moment, les États-Unis construisaient le canal Érié (achevé en 1825), menaçant de détourner le commerce des Grands Lacs vers le sud, à New York[7][7]. La communauté d'affaires de Montréal craignait de perdre du commerce au profit de cette route rivale, ainsi qu'aux colonies agricoles en croissance du Haut-Canada. En réponse, un groupe d'éminents marchands montréalais a formé la Compagnie des Propriétaires du Canal de Lachine pour financer et construire un canal qui contournerait les rapides de Lachine et capterait le commerce de l'ouest pour Montréal[8][9]. À la tête de cette initiative se trouvait John Richardson, un riche marchand et cofondateur de la Banque de Montréal, ainsi que d'autres personnalités telles que John Redpath, un jeune entrepreneur écossais immigrant, et les entrepreneurs Thomas McKay, Abner Bagg, et d'autres[10]. Soutenus par ce consortium et avec l'appui du gouvernement, les plans du canal de Lachine sont finalement passés de l'aspiration à la réalité dans les années 1820.
Construction du canal (1821–1825)
La construction du canal de Lachine a officiellement débuté le 17 juillet 1821, une date marquée par le premier coup de pelle de John Richardson[11]. L'ingénieur en chef du projet était Thomas Burnett, John Richardson agissant en tant que gestionnaire, et des entrepreneurs comme John Redpath supervisant les équipes de travail[10]. La tâche était monumentale pour l'époque : les travailleurs devaient creuser un chenal d'environ 14 km de long, de l'ancien port de Montréal au lac Saint-Louis (faisant partie du Saint-Laurent), taillant la terre et la roche à la main[12][13]. La majeure partie de la main-d'œuvre – environ 800 à 1000 hommes – était composée d'immigrants irlandais, récemment arrivés et désespérés de trouver du travail[14][12]. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule six jours par semaine, armés de pioches, de pelles, de brouettes et de poudre noire pour le dynamitage, réalisant des prouesses d'ingénierie civile avec des outils rudimentaires[12]. Environ un tiers du tracé du canal traversait de la roche solide, qui devait être fendue et retirée à la main à une époque précédant les machines modernes[15][13]. Malgré de fréquents accidents, des épidémies et des conditions de travail difficiles typiques des premiers projets de canal, le creusement a progressé régulièrement.
Sous la supervision de Burnett, le canal original a été achevé en 1824 et officiellement ouvert à la navigation en 1825[16]. La voie navigable achevée comportait sept écluses en maçonnerie, chacune d'environ 30 m de long, 6 m de large et 1,5 m de profondeur, pour accueillir le faible tirant d'eau des vapeurs et des bateaux de l'époque[16]. Ces écluses faisaient franchir aux navires une dénivellation totale de 14 mètres, du port de Montréal jusqu'au niveau du lac Saint-Louis. Le canal comprenait également des structures auxiliaires comme des vannes d'écluse en bois, des déversoirs et un tunnel d'alimentation en eau. Lorsque le canal de Lachine a ouvert en 1825, il a immédiatement tenu sa promesse d'améliorer le transport : le fret et les passagers pouvaient désormais voyager en bateau au-delà de Montréal, évitant les rapides auparavant infranchissables[1]. Cela a considérablement réduit le coût et le temps de déplacement des marchandises entre Montréal et la région des Grands Lacs. Montréal est rapidement devenu le principal port de transbordement pour le Haut-Canada – un avantage qui l'a aidé à éclipser la ville de Québec en tant que principal port d'entrée vers l'intérieur du Canada[17]. Au cours des 15 premières années, le trafic sur le canal a explosé : le nombre de navires l'utilisant a été multiplié par sept, et le trafic de passagers par cinq, entre le milieu des années 1820 et 1840[18]. Le succès du canal au cours de ces premières années a validé la vision de ses fondateurs et a positionné Montréal comme un pôle commercial en pleine croissance sur le Saint-Laurent.
Première expansion et débuts industriels (1825–1850)
Vue historique du canal de Lachine vers 1910, avec des élévateurs à grain et des bâtiments industriels bordant ses rives. La création du canal a transformé Montréal en un port intérieur majeur et a attiré des usines au bord de l'eau[19]. La croissance rapide du trafic sur le canal a rapidement révélé les limites des écluses originales, petites, et du chenal peu profond. Dans les années 1840, de plus grands vapeurs naviguaient sur le Saint-Laurent, et la capacité du canal de Lachine était devenue un goulot d'étranglement. Les commissaires du port de Montréal, dirigés par des personnalités comme John Young, ont fait pression pour des améliorations afin d'accueillir de plus grands navires[20]. Des changements politiques ont également facilité l'action : l'union du Haut et du Bas-Canada en 1840 a placé les projets de canal sous une administration unifiée, et le gouvernement britannique a lancé un ambitieux programme d'élargissement des canaux pour stimuler le commerce canadien[21]. Entre 1843 et 1848, le canal de Lachine a subi sa première grande expansion sous l'ingénieur Alfred Barrett[22]. Les travailleurs ont approfondi et élargi le canal, et les sept écluses originales ont été remplacées par cinq nouvelles écluses, chacune de 61 m (200 pi) de long, 13,5 m (44 pi) de large et 2,7 m (9 pi) de profondeur – doublant approximativement les dimensions précédentes des écluses du canal[22]. Cette expansion a permis au canal de gérer des navires plus lourds et plus longs, augmentant considérablement sa capacité de débit.
L'élargissement des années 1840 a eu un effet secondaire imprévu mais transformateur : il a permis au canal de générer de l'énergie hydraulique pour l'industrie. En installant des barrages de régulation et des vannes industrielles, les ingénieurs ont exploité l'eau s'écoulant par le canal pour entraîner des roues hydrauliques et des turbines dans les usines adjacentes[23]. Presque immédiatement après l'élargissement du canal en 1848, les entrepreneurs ont profité de cette nouvelle source d'énergie bon marché. Des usines ont poussé le long des rives du canal, en particulier près des écluses et des bassins où la chute du niveau d'eau était la plus importante et où l'énergie pouvait être exploitée[24][25]. En quelques années, une trentaine de nouveaux établissements industriels étaient en activité, des moulins à farine et fonderies de métaux aux brasseries et tanneries, donnant un coup de fouet au secteur manufacturier de Montréal[26][25]. Cette période a marqué le premier essor industriel de Montréal, alors que des investisseurs locaux comme John Redpath (qui a fondé la Raffinerie de sucre du Canada en 1854) construisaient des moulins et des usines le long du canal[27]. La disponibilité de l'énergie hydraulique et l'amélioration des transports ont transformé ensemble le corridor du canal de Lachine en le berceau de l'industrie canadienne au milieu du XIXe siècle[28]. Dans les années 1850, trois grands moulins à farine autour du bassin n° 2 du canal produisaient 65 % de toute la farine produite dans l'Est du Canada, et un groupe de clouteries à proximité produisait plus de 80 % des clous sur le marché canadien[27]. L'influence du canal s'est ainsi rapidement étendue au-delà de la navigation – il est devenu un moteur industriel attirant population et investissements à Montréal.
Deuxième expansion et apogée industrielle (années 1870–1920)
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le canal de Lachine a été de nouveau agrandi pour répondre aux exigences d'une nation en croissance et d'une économie en industrialisation. Après la Confédération canadienne en 1867, le gouvernement fédéral a adopté une « Politique nationale » qui priorisait le commerce est-ouest au sein du Canada et le développement de l'Ouest. Une infrastructure de transport efficace était essentielle à cette stratégie[29]. Dans les années 1870, avec l'augmentation des récoltes de blé des Prairies et des machines lourdes de l'Ontario, même le canal élargi approchait de sa capacité maximale. En 1872, une enquête gouvernementale a recommandé un deuxième élargissement du système de canaux du Saint-Laurent pour gérer le commerce continental[30]. Les travaux de la deuxième expansion du canal de Lachine ont commencé en 1873 et se sont poursuivis jusqu'au début des années 1880[31]. À son achèvement en 1885, les écluses du canal ont été allongées à 82 m (269 pi) et approfondies à environ 4,3 m (14 pi), avec l'ajout de mécanismes de porte électromécaniques quelques années plus tard pour améliorer le débit[32][31]. Cette expansion s'est synchronisée avec des améliorations apportées à d'autres chenaux de navigation (comme le nouveau canal de Soulanges à l'ouest de Montréal), créant une voie navigable continue à grand tirant d'eau des Grands Lacs à Montréal. Dans les années 1890, les navires océaniques pouvaient parcourir les 2 100 km de l'océan Atlantique jusqu'au lac Supérieur, surmontant une dénivellation totale de 164 m via un réseau d'écluses[33]. Montréal avait consolidé son rôle de port d'entrée reliant l'intérieur de l'Amérique du Nord aux routes commerciales mondiales[33].
Le canal élargi de la fin du XIXe siècle a coïncidé avec l'apogée de la croissance industrielle de Montréal. N'étant plus limitée à l'industrie légère mue par l'eau, la zone du canal a attiré des industries manufacturières plus lourdes et d'énormes usines. La période d'environ 1880 à 1930 a marqué l'apogée du canal en tant que corridor industriel[34][35]. Initialement, les industries se sont regroupées sur les sites d'énergie hydraulique près de l'extrémité est du canal, mais après 1880, elles se sont étendues le long de toute la voie navigable, y compris ses tronçons occidentaux dans les municipalités de l'époque de Saint-Pierre et LaSalle[34]. De nouveaux secteurs ont pris racine : de gigantesques usines textiles ont été établies dans les années 1880, suivies par la chimie, la pétrochimie et de grandes usines sidérurgiques au début du XXe siècle[36][35]. Les Minoteries Ogilvie, qui ont construit leur immense usine près du canal, sont finalement devenues la plus grande entreprise de minoterie de l'Empire britannique et, pendant un temps, la plus grande minoterie du monde[37]. Dans le secteur de l'acier, les Montreal Rolling Mills (fondées en 1868 à côté du canal) ont progressivement absorbé les concurrents locaux et ont fusionné en 1911 pour former Stelco (Steel Company of Canada) – marquant la prééminence de Montréal dans la production d'acier[38]. De nombreuses autres entreprises emblématiques opéraient sur les rives du canal : la Dominion Bridge Company fabriquait de l'acier de construction et l'expédiait via le canal pour construire des ponts majeurs (y compris le pont Jacques-Cartier de Montréal)[19] ; le chantier naval d'Augustin Cantin produisait des bateaux à vapeur dans le secteur Saint-Gabriel ; et la Raffinerie de sucre Redpath transformait le sucre brut des Caraïbes en des centaines de barils de sucre raffiné chaque jour[27]. Au total, au cours du premier siècle du canal, plus de 600 industries se sont établies le long de cette voie navigable, représentant pratiquement tous les secteurs manufacturiers[39]. L'interdépendance entre ces entreprises a formé un écosystème industriel autonome : par exemple, les aciéries fournissaient des pièces de machines à d'autres usines, qui à leur tour construisaient des équipements pour les chemins de fer et les navires desservant le canal[40]. Ce dynamisme industriel a propulsé la croissance de Montréal, la transformant d'une ville du milieu du XIXe siècle en la plus grande ville du Canada au début du XXe siècle. La population de Montréal a quadruplé entre 1850 et 1900, alimentée par un afflux de travailleurs pour les usines situées le long du canal[41]. Des quartiers ouvriers entiers – Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, entre autres – se sont développés à proximité du canal, abritant des milliers de travailleurs irlandais, canadiens-français et autres qui gagnaient leur vie dans les usines et les chantiers le long de l'eau[41][42]. En 1900, le canal de Lachine n'était pas seulement une infrastructure, mais la colonne vertébrale de l'économie montréalaise et un catalyseur de son urbanisation et de sa société ouvrière multiculturelle.
Influence sur le commerce, l'industrie et la croissance de Montréal
L'impact du canal de Lachine sur Montréal aux XIXe et début du XXe siècles a été profond, remodelant le destin économique de la ville. Stratégiquement, le canal a donné à Montréal un avantage concurrentiel dans le commerce continental. En permettant aux navires de contourner les rapides de Lachine, Montréal est devenue le point de navigation effectif pour les navires océaniques remontant le Saint-Laurent. Cela a détourné le commerce de gros des ports rivaux : par exemple, une grande partie des céréales et du bois du Haut-Canada qui auraient pu autrefois passer par Québec ou par des routes américaines ont été acheminées via Montréal après 1825[17]. Le canal a ainsi contribué à établir Montréal comme le principal port et la capitale commerciale du Canada au XIXe siècle. Il a également intégré Montréal dans l'économie plus large des Grands Lacs – la ville a servi de point de transit pour les marchandises circulant entre l'Europe, le Canada atlantique et le Midwest américain, ce qui lui a valu le surnom de « port des Prairies ».
Sur le plan industriel, le canal a été le moteur de la révolution industrielle de Montréal. Il a fourni les deux ingrédients clés du succès manufacturier : un transport fiable et une énergie abondante (l'énergie hydraulique, complétée plus tard par le charbon livré par canal et par rail)[43][44]. Les usines bordant le canal produisaient une gamme étonnante de marchandises : produits sidérurgiques, locomotives, moteurs de navires, textiles, farine, sucre, bière, cuir et quincaillerie, pour n'en nommer que quelques-uns. À la fin du XIXe siècle, le district industriel du canal de Lachine était le plus grand du Canada, tant par le nombre d'entreprises que par la diversité de sa production[45]. À son apogée, les usines situées le long du canal employaient plus de 20 % de la main-d'œuvre totale de Montréal, formant le cœur manufacturier du pays[45]. Les entreprises de ce corridor ont réalisé des économies d'échelle et une domination nationale – par exemple, le conglomérat de métallurgies qui a formé Stelco a fait de Montréal un centre de production de fer et d'acier[37], et l'énorme minoterie d'Ogilvie près du canal a alimenté les consommateurs à travers le Canada. Le canal a également stimulé le développement d'activités connexes : des élévateurs à grains ont été construits le long de ses rives pour stocker les céréales de l'Ouest, des gares de triage et des entrepôts ont proliféré pour gérer le fret, et des banques et compagnies d'assurance (y compris la Banque de Montréal, cofondée par Richardson) ont financé le commerce florissant[46][47]. L'ascension de Montréal en tant que principale métropole du Canada à l'ère victorienne peut être directement attribuée à cette croissance industrielle et commerciale le long du canal de Lachine. Le succès du corridor du canal a même eu des implications régionales plus larges – il a modifié l'équilibre du pouvoir économique au Canada, contribuant au déclin de l'économie maritime des provinces de l'Atlantique à mesure que le commerce était acheminé par le port intérieur de Montréal[17][48].
Sur les plans social et urbanistique, l'influence du canal a été tout aussi significative. La nécessité de loger l'énorme main-d'œuvre industrielle a conduit à l'urbanisation rapide du sud-ouest de Montréal. Des quartiers ouvriers ont surgi, caractérisés par des rangées de modestes duplex en brique et de maisons en rangée dans les quartiers adjacents au canal. Ces communautés, telles que Pointe-Saint-Charles (près du terminus du canal), Griffintown et Saint-Henri (près de ses sections centrale et supérieure), sont devenues des enclaves vibrantes de travailleurs majoritairement immigrants – notamment irlandais, mais aussi canadiens-français et autres[41][14]. Ils ont grandement contribué à la mosaïque culturelle et à l'histoire du travail de Montréal (la région a connu certaines des premières grèves ouvrières industrielles du Canada, y compris une grève de 1843 des travailleurs irlandais du canal réclamant de meilleurs salaires)[49]. La présence du canal a également influencé la forme urbaine de Montréal : il a créé une barrière physique et une limite pour les quartiers, a rendu nécessaires de nouveaux ponts et liaisons de transport, et a orienté l'expansion de la ville vers l'ouest le long de ses rives. En bref, le canal de Lachine n'était pas seulement une voie navigable ; il a été la force motrice de la transformation de Montréal en ville industrielle au XIXe siècle et un maillon essentiel des réseaux commerciaux canadiens. Son héritage est inscrit dans la silhouette de Montréal, avec ses silos et ses cheminées, dans la prospérité de la ville à cette époque, et dans la composition même de la population diversifiée de Montréal dont les ancêtres ont travaillé le long du canal.
Déclin du rôle industriel du canal et sa fermeture
Au milieu du XXe siècle, le succès même du canal de Lachine avait préparé le terrain pour son obsolescence. L'ampleur du transport maritime et de l'industrie mondiale avait dépassé les dimensions finies et l'emplacement urbain du canal. Après la Seconde Guerre mondiale, la taille des navires a continué d'augmenter bien au-delà de ce que les écluses du canal (même après deux élargissements) pouvaient accueillir[50]. Le canal, enserré par un développement urbain dense, ne pouvait pas être élargi une troisième fois[50]. De plus, de nouvelles technologies et routes de transport ont émergé. Les chemins de fer avaient depuis longtemps repris une grande partie du trafic de marchandises, et l'amélioration des autoroutes et du transport routier au milieu des années 1900 offrait un transport de point à point sans les contraintes des écluses et des canaux[51]. De manière décisive, l'ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959 a fourni une route directe en eau profonde pour les navires, contournant entièrement les canaux peu profonds de Montréal[52]. Les nouvelles écluses de la Voie maritime sur la Rive-Sud du Saint-Laurent pouvaient accueillir des navires océaniques, rendant le canal de Lachine, long de 14 km, superflu pour la navigation commerciale. Le fret qui devait autrefois faire un détour par le canal passait désormais directement devant Montréal. En conséquence, le trafic maritime sur le canal de Lachine a chuté dans les années 1960.
L'industrie le long du canal a également connu un déclin abrupt après la guerre. Certaines industries lourdes, comme la sidérurgie et la construction navale, ont migré vers des installations plus modernes ou vers des sites riverains sur la Voie maritime. D'autres ont simplement fermé leurs portes à mesure que l'économie évoluait. Le célèbre corridor d'usines du canal s'est progressivement tu. Le canal de Lachine a officiellement fermé à la navigation commerciale en 1970, après 145 ans de service[50][53]. Dès les années 1960, des sections du canal avaient été comblées ou coupées – notamment la partie inférieure près du Vieux-Port a été remblayée entre 1965 et 1967, coupant la connexion originale du canal au centre-ville de Montréal[54]. La fermeture a été un coup symbolique et pratique pour les quartiers adjacents du sud-ouest de Montréal. Ces quartiers s'étaient développés grâce aux industries du canal, et à mesure que les usines fermaient ou déménageaient, le chômage et la dégradation urbaine se sont installés. De nombreux bâtiments industriels ont été abandonnés ; certains ont été démolis et laissés comme friches industrielles vacantes[55]. Dans les années 1980, le « Hall de la machinerie » du Canada, autrefois animé, était devenu un paysage rouillé d'entrepôts silencieux, d'eaux polluées et de communautés urbaines en déclin. Un compte rendu contemporain a qualifié le canal fermé de « site du patrimoine national languissant dans une soupe toxique », faisant allusion aux sédiments et aux sites d'usines fortement contaminés le long de son parcours[56]. En effet, des générations de déchets industriels non réglementés avaient gravement pollué l'eau et les rives du canal – un défi majeur qui devrait être relevé dans tout futur plan de réutilisation.
Pourtant, même à son plus bas, l'importance historique du canal de Lachine a été formellement reconnue. Dès 1929, le canal de Lachine avait été désigné Lieu historique national du Canada, reconnaissant son importance pour le patrimoine du pays[57]. En 1996, la Commission des lieux et monuments historiques est allée plus loin, déclarant l'ensemble du corridor du canal « Complexe manufacturier du canal de Lachine » Lieu historique national pour honorer son rôle central dans l'industrialisation du Canada[45]. De telles désignations reflétaient un sentiment croissant que le canal, bien que n'étant plus économiquement vital, était un atout culturel inestimable qui méritait d'être préservé. Cela a préparé le terrain pour des efforts concertés visant à réhabiliter et à réinventer le canal de Lachine à la fin du XXe siècle.
Restauration et transformation en voie navigable récréative
Après sa fermeture, le canal de Lachine a passé plusieurs décennies dans l'incertitude, mais un plan de revitalisation a lentement pris forme au cours des années 1970-1990. En 1978, Parcs Canada s'est vu confier la gestion du Lieu historique national du Canal-de-Lachine, un signe clair que le gouvernement voyait un potentiel dans la préservation et la réaffectation du canal[58]. Cependant, la simple réouverture du canal n'était pas simple. Une vaste réhabilitation environnementale était nécessaire : des études ont révélé que plus d'un siècle d'activité industrielle avait laissé des sédiments toxiques (contenant des métaux lourds, des huiles et des produits chimiques) tapissant le lit du canal[59]. Les terrains adjacents, tels que d'anciennes usines à gaz, des dépôts de charbon et des usines, étaient également contaminés. Tout au long des années 1990, un examen environnemental conjoint fédéral-provincial a étudié comment décontaminer le canal en toute sécurité. Cela a conduit à un vaste projet de nettoyage impliquant le dragage des sédiments, l'enlèvement des sols pollués et la construction d'installations de confinement pour les matières dangereuses[60][61]. Parallèlement, les ingénieurs ont restauré les murs de pierre effrités du canal, réhabilité les anciennes écluses et ponts, et même retiré certaines obstructions de chaussée qui avaient été construites à travers le canal désaffecté. L'objectif n'était pas seulement la restauration environnementale, mais aussi de « revitaliser le site tout en préservant son patrimoine unique », comme l'indiquait un mandat de projet de 1997[62].
Finalement, après des décennies d'inactivité, le canal de Lachine a été rouvert en mai 2002 à la navigation de plaisance[63][64]. Pour la première fois depuis 1970, l'eau a de nouveau circulé dans toutes les écluses et les bateaux de plaisance ont pu parcourir toute la longueur du canal. Le canal moderne fonctionne désormais du printemps à l'automne comme une voie navigable urbaine pour les kayaks, les canoës et les petits bateaux de tourisme, avec cinq écluses en service (les mêmes chambres d'écluses des agrandissements du XIXe siècle, restaurées pour être réutilisées)[64]. La navigation est limitée aux embarcations ayant un tirant d'eau d'environ 2 m et un faible tirant d'air (en raison du gabarit des ponts), ce qui la restreint de fait aux navires de plaisance[64]. Bien qu'il ne transporte plus de cargos, la renaissance du canal en tant que parc-voie navigable historique a été un succès retentissant. Les chemins de halage et les voies de service le long du canal ont été convertis en une piste cyclable et piétonnière continue, qui est rapidement devenue l'un des aménagements extérieurs les plus prisés de Montréal. En 2009, le magazine Time a classé la piste du canal de Lachine parmi les meilleures pistes cyclables urbaines au monde[64]. Des milliers de résidents et de touristes utilisent désormais le canal quotidiennement pour le jogging, le vélo, les pique-niques, et même le patinage sur glace en hiver lorsque des sections de l'eau gèlent.
Le réaménagement urbain le long des berges du canal a été tout aussi transformateur. Avec la voie navigable assainie et accessible, les terrains industriels abandonnés sont devenus des opportunités pour de nouvelles utilisations. Les années 1990 et 2000 ont vu une vague de projets de réaffectation adaptative dans le corridor, mêlant conservation du patrimoine et développement immobilier[65]. De majestueuses usines et entrepôts en briques rouges du XIXe siècle ont été convertis en condominiums, bureaux et espaces artistiques – conservant souvent leurs façades historiques et leurs machines comme éléments architecturaux. Par exemple, l'immense usine Dominion Textiles et la fabrique de la Simmons Bedding Company ont été réaménagées en complexes résidentiels de style loft, déclenchant la revitalisation du quartier Saint-Henri[65]. L'ancien bâtiment de la raffinerie de sucre Redpath, abandonné après la fermeture de la raffinerie en 1980, a également été partiellement transformé en lofts haut de gamme, préservant ainsi un lien avec le passé industriel du canal[66]. Des espaces publics ont été créés là où se trouvaient autrefois des usines : le Marché Atwater, un bâtiment Art déco près du canal (initialement construit en 1933 comme marché municipal sur un ancien dépôt de bois), a été rajeuni et grouille aujourd'hui de vendeurs de produits alimentaires et d'acheteurs, ancrant un centre communautaire animé[67]. Ces aménagements ont considérablement amélioré le paysage – ce qui était autrefois une ceinture industrielle dégradée est maintenant un mélange de parcs verdoyants, de promenades et de quartiers branchés. Les valeurs immobilières dans les zones adjacentes au canal ont augmenté, et de jeunes familles et professionnels s'y sont installés, inversant des décennies de déclin[68]. En même temps, les urbanistes ont cherché à équilibrer la croissance et le patrimoine : de nombreuses structures historiques (écluses, ponts, entrepôts en pierre) sont protégées, et les nouvelles constructions sont réglementées pour maintenir les perspectives visuelles et le caractère du canal. Le résultat est souvent cité comme un modèle de revitalisation de friches industrielles urbaines, montrant comment une ancienne infrastructure industrielle peut être réaffectée à des fins culturelles et récréatives tout en stimulant le développement économique[65][42].
Héritage culturel et environnemental aujourd'hui
Le canal de Lachine aujourd'hui, transformé en voie navigable récréative. D'anciens bâtiments industriels ont été restaurés en lofts résidentiels et en espaces publics, et une piste cyclable populaire longe le canal, avec le centre-ville de Montréal visible au loin. Deux siècles après sa construction, le canal de Lachine est à la fois un monument historique vivant et un espace vert urbain vital. En 2025, le canal célébrera son 200e anniversaire[69][70] – une étape qui souligne son importance durable pour Montréal et le Canada. Parcs Canada, qui administre le site, commémore activement le patrimoine du canal par le biais de musées, de panneaux d'interprétation et d'événements. Un petit musée à l'extrémité ouest (près du Vieux-Lachine) se concentre sur l'ère de la traite des fourrures, rappelant aux visiteurs que la zone du canal était un point de convergence du commerce autochtone et européen avant même la construction du canal[71]. Le long du canal, on trouve des maisons d'éclusiers du XIXe siècle préservées, des vestiges d'anciens ponts tournants, et même des silos à grains et des chevalets de chemin de fer abandonnés, tous soigneusement intégrés dans le cadre du parc historique. Ces artefacts offrent un aperçu tangible de l'ère de la construction du canal et de la révolution industrielle qu'il a ensuite déclenchée. En 1996, comme mentionné, le corridor industriel du canal a reçu sa propre désignation de lieu historique national, assurant ainsi la protection fédérale de son caractère[45]. Les Montréalais reconnaissent désormais des noms comme Griffintown et Pointe-Saint-Charles non seulement comme des quartiers, mais comme d'importants paysages patrimoniaux façonnés par le canal et les travailleurs qui y ont œuvré. Le canal de Lachine est ainsi devenu un point central de la mémoire collective – un musée à ciel ouvert du passé industriel de Montréal et un emblème de la résilience et de la réinvention de la ville.
Sur le plan environnemental, la restauration du canal a également eu des impacts positifs. Le projet de décontamination complet mené à la fin du XXe siècle a éliminé ou isolé une grande partie de l'héritage toxique de la période industrielle du canal[60][72]. La qualité de l'eau du canal s'est nettement améliorée ; les plantes aquatiques et les poissons sont progressivement revenus dans certaines sections du canal, et des oiseaux et de petits animaux sauvages urbains sont fréquemment observés le long des berges. Le canal sert désormais de corridor bleu-vert de 14 km au cœur de Montréal, contribuant à la biodiversité urbaine et offrant aux résidents un accès aux voies navigables pour des activités comme le kayak et la pêche (avec remise à l'eau) dans une ville par ailleurs densément bâtie. La gestion continue de Parcs Canada comprend la surveillance de toute pollution résiduelle et l'organisation d'événements de nettoyage communautaires pour maintenir la propreté du canal[73]. Essentiellement, une zone autrefois qualifiée de « soupe toxique » environnementale[74] a été transformée en un habitat sûr et accueillant, illustrant le potentiel de réhabilitation écologique des sites industriels.
Sur le plan culturel, la renaissance du canal de Lachine a également suscité une appréciation plus large du patrimoine industriel au Canada. L'histoire du canal – de l'ambitieux exploit d'ingénierie des années 1820 à la puissance industrielle, puis à l'abandon et au renouveau – a fait l'objet d'études savantes, de romans, de films documentaires et d'installations artistiques. Par exemple, un documentaire de 2023, For It Shall Rule, a retracé l'évolution du canal et sa relation avec la modernité[75][76]. Des projets d'art public pour le 200e anniversaire du canal intègrent des machines historiques (telles que l'ancienne grue à coke de LaSalle, une relique imposante de 1916) comme installations qui célèbrent l'histoire ouvrière du site[77][78]. Le canal est ainsi devenu une toile d'expression créative sur le passé et l'avenir de Montréal. Il demeure également un lieu de rassemblement communautaire – chaque année, des centaines de milliers de personnes parcourent ses sentiers à vélo ou à pied, et des festivals et événements saisonniers animent ses berges. Selon Parcs Canada, l'objectif est de « mettre en valeur ce site patrimonial » et de « donner vie à ce magnifique site historique » pour les nouvelles générations[79].
En conclusion, le canal de Lachine est une pierre angulaire de la géographie historique de Montréal et un microcosme du parcours du Canada, de la colonie à la nation industrielle, puis à la société post-industrielle. Construit pour contourner un obstacle naturel, il a fini par sculpter le paysage économique et social de la ville pendant plus d'un siècle. Le canal a permis à Montréal de prospérer en tant que carrefour commercial et centre industriel au XIXe siècle, puis a connu un déclin au milieu du XXe siècle à mesure que la technologie et les modèles commerciaux évoluaient. Aujourd'hui, grâce à la restauration et à la réaffectation adaptative, le canal de Lachine a trouvé un nouveau rôle en tant que parc récréatif riche en patrimoine, tout en préservant les échos de la révolution industrielle canadienne. Il est un exemple de la façon dont les infrastructures peuvent évoluer au fil du temps – d'un canal fonctionnel qui a alimenté une économie à un paysage culturel qui enrichit la vie urbaine. La célébration continue du bicentenaire du canal en 2025 ne vise pas seulement à marquer l'âge d'une ancienne voie navigable, mais à reconnaître son importance durable dans l'histoire de Montréal et de la nation.
Références :
-
Desaulniers, F. « Canal de Lachine. » L'Encyclopédie canadienne. Historica Canada, 2012/2016.[80][81]
-
Parcs Canada. « Le premier maillon du réseau de canaux » – Histoire du lieu historique national du Canal-de-Lachine. Gouvernement du Canada, mis à jour en 2025.[7][11]
-
Parcs Canada. « Le berceau de l'industrialisation » – Histoire du lieu historique national du Canal-de-Lachine. Gouvernement du Canada, 2025.[27][28]
-
Parcs Canada. « 200 ans de souvenirs au canal de Lachine. » LHN du Canal-de-Lachine – Quoi de neuf, 2025.[82][83]
-
Société canadienne de génie civil. « Canal de Lachine. » Lieu historique national de génie civil, 2002.[84][32]
-
Yvon Desloges & Alain Gelly. Le canal de Lachine : Au rythme des vagues du développement urbain 1860–1950. Septentrion (Canada), 2002.[85]
-
Yvon Desloges. « Les coulisses du paysage du canal de Lachine. » IA, Journal of the Society for Industrial Archeology, vol. 29 no. 1, 2003, pp. 7–20.[86]
-
Desmond Bliek & Pierre Gauthier. « Comprendre la forme bâtie de l'industrialisation le long du canal de Lachine. » Urban History Review, vol. 35 no. 1, 2006, pp. 3–17.[87][88]
-
Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Procès-verbal de la réunion, 1996 – Désignation du complexe manufacturier du canal de Lachine. Ottawa, 1996.[45]
-
Comité conjoint d'évaluation environnementale. « Projet de décontamination du canal de Lachine – Rapport final. » Agence canadienne d'évaluation environnementale & BAPE du Québec, 1996.[60][61]
Sources externes
À propos de 2727 Coworking
2727 Coworking is a vibrant and thoughtfully designed workspace ideally situated along the picturesque Lachine Canal in Montreal's trendy Griffintown neighborhood. Just steps away from the renowned Atwater Market, members can enjoy scenic canal views and relaxing green-space walks during their breaks.
Accessibility is excellent, boasting an impressive 88 Walk Score, 83 Transit Score, and a perfect 96 Bike Score, making it a "Biker's Paradise". The location is further enhanced by being just 100 meters from the Charlevoix metro station, ensuring a quick, convenient, and weather-proof commute for members and their clients.
The workspace is designed with flexibility and productivity in mind, offering 24/7 secure access—perfect for global teams and night owls. Connectivity is top-tier, with gigabit fibre internet providing fast, low-latency connections ideal for developers, streamers, and virtual meetings. Members can choose from a versatile workspace menu tailored to various budgets, ranging from hot-desks at $300 to dedicated desks at $450 and private offices accommodating 1–10 people priced from $600 to $3,000+. Day passes are competitively priced at $40.
2727 Coworking goes beyond standard offerings by including access to a fully-equipped, 9-seat conference room at no additional charge. Privacy needs are met with dedicated phone booths, while ergonomically designed offices featuring floor-to-ceiling windows, natural wood accents, and abundant greenery foster wellness and productivity.
Amenities abound, including a fully-stocked kitchen with unlimited specialty coffee, tea, and filtered water. Cyclists, runners, and fitness enthusiasts benefit from on-site showers and bike racks, encouraging an eco-conscious commute and active lifestyle. The pet-friendly policy warmly welcomes furry companions, adding to the inclusive and vibrant community atmosphere.
Members enjoy additional perks like outdoor terraces and easy access to canal parks, ideal for mindfulness breaks or casual meetings. Dedicated lockers, mailbox services, comprehensive printing and scanning facilities, and a variety of office supplies and AV gear ensure convenience and efficiency. Safety and security are prioritized through barrier-free access, CCTV surveillance, alarm systems, regular disinfection protocols, and after-hours security.
The workspace boasts exceptional customer satisfaction, reflected in its stellar ratings—5.0/5 on Coworker, 4.9/5 on Google, and 4.7/5 on LiquidSpace—alongside glowing testimonials praising its calm environment, immaculate cleanliness, ergonomic furniture, and attentive staff. The bilingual environment further complements Montreal's cosmopolitan business landscape.
Networking is organically encouraged through an open-concept design, regular community events, and informal networking opportunities in shared spaces and a sun-drenched lounge area facing the canal. Additionally, the building hosts a retail café and provides convenient proximity to gourmet eats at Atwater Market and recreational activities such as kayaking along the stunning canal boardwalk.
Flexible month-to-month terms and transparent online booking streamline scalability for growing startups, with suites available for up to 12 desks to accommodate future expansion effortlessly. Recognized as one of Montreal's top coworking spaces, 2727 Coworking enjoys broad visibility across major platforms including Coworker, LiquidSpace, CoworkingCafe, and Office Hub, underscoring its credibility and popularity in the market.
Overall, 2727 Coworking combines convenience, luxury, productivity, community, and flexibility, creating an ideal workspace tailored to modern professionals and innovative teams.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Aucune déclaration ou garantie n'est faite concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de son contenu. Toute utilisation de ces informations est à vos propres risques. 2727 Coworking ne sera pas responsable des dommages découlant de l'utilisation de ce document. Ce contenu peut inclure du matériel généré avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, qui peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Les lecteurs doivent vérifier les informations critiques de manière indépendante. Tous les noms de produits, marques de commerce et marques déposées mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins d'identification uniquement. L'utilisation de ces noms n'implique pas l'approbation. Ce document ne constitue pas un conseil professionnel ou juridique. Pour des conseils spécifiques liés à vos besoins, veuillez consulter des professionnels qualifiés.