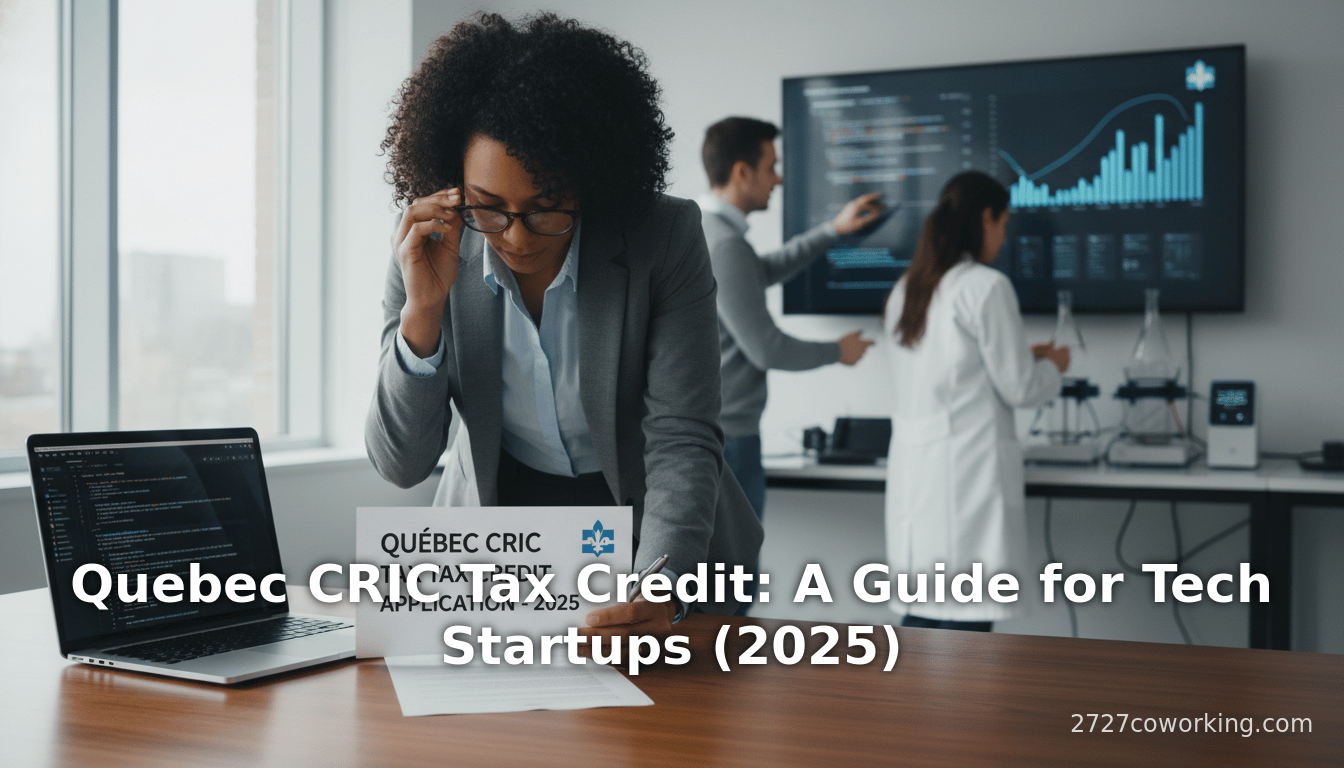
Crédit d'impôt CRIC du Québec : Guide pour les startups technologiques (2025)
Sommaire
La province de Québec a remanié son régime de crédits d'impôt pour la R&D, remplaçant une mosaïque d'incitatifs distincts par un seul Crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation (CRIC), applicable aux années d'imposition débutant après le 25 mars 2025 [1] [2]. Ce nouveau crédit remboursable regroupe plusieurs anciens crédits (par exemple, pour les salaires, les sous-traitants, la recherche universitaire, la recherche précompétitive, etc.) en un programme simplifié [1] [3]. Dans le cadre du CRIC, les sociétés québécoises admissibles (et les partenariats qualifiés) peuvent demander un crédit de 30 % sur le premier million de dollars de dépenses de R&D admissibles (au-delà d'un seuil d'exclusion) et un crédit de 20 % sur toute dépense admissible supplémentaire [4] [5]. Il est crucial de noter que le CRIC est entièrement remboursable, ce qui signifie que même les startups pré-rentables (avant revenus) reçoivent des remboursements en espèces [6] [7].
Pour les startups technologiques, cela représente une opportunité générationnelle. Les crédits fédéraux de la RS&DE peuvent être cumulés avec le CRIC du Québec pour couvrir bien plus de la moitié des coûts de R&D admissibles. Par exemple, une analyse note que les startups québécoises peuvent obtenir des crédits effectifs combinés dépassant 50 % sur les dépenses admissibles lorsque les taux de 30 %/20 % du Québec sont jumelés au crédit fédéral de la RS&DE, ce qui rapporte environ 600 000 $ sur un investissement de 1 M$ [8] [9]. Le CRIC élargit également l'admissibilité : au-delà de la R&D classique, il inclut les dépenses en capital (nouveaux équipements de laboratoire, machines, etc.) et les activités de précommercialisation (tests, validation, approbations réglementaires, conception de produits) comme dépenses admissibles [10] [11]. Un seuil d'exclusion s'applique – le plus élevé de 50 000 $ ou d'un seuil basé sur le montant personnel par employé de R&D (par exemple, 18 751 $ en 2025, au prorata) [12] [13] – mais la plupart des startups actives le dépassent rapidement. En somme, le Québec mise 2,4 milliards de dollars sur cinq ans sur cette initiative du CRIC pour faire de la province « la principale juridiction d'innovation en Amérique du Nord » [14].
Ce rapport fournit un plan détaillé étape par étape pour que les startups technologiques québécoises comprennent le CRIC et puissent en faire la demande. Il commence par un contexte historique sur les incitatifs québécois liés à la RS&DE, puis détaille les réformes de 2025 et les règles du nouveau crédit. Nous analysons les critères d'admissibilité, les activités admissibles et le processus de demande, illustrant avec des données et des exemples concrets. Des sources expertes (communiqués gouvernementaux, analyses de conseillers fiscaux) sont citées tout au long pour étayer chaque affirmation. Un tableau comparatif clair est inclus pour contraster les anciens et nouveaux incitatifs du Québec avec le programme fédéral. Enfin, nous discutons des implications pour la stratégie d'innovation, y compris la maximisation de la valeur du crédit, les pièges potentiels et les perspectives d'avenir. En suivant ce guide, les entreprises technologiques québécoises peuvent naviguer dans le système du CRIC en toute confiance et exploiter l'un des régimes fiscaux de R&D les plus généreux au monde.
Introduction et Contexte
L'innovation est le moteur du succès des startups technologiques, mais la R&D est coûteuse. L'incitatif fiscal pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) au Canada est « le plus important programme du gouvernement du Canada soutenant la R&D industrielle » [15]. Établi au niveau fédéral dans les années 1980, il offre des crédits d'impôt à l'investissement (CII) pour les dépenses de R&D admissibles. Les provinces reproduisent souvent ou complètent les crédits fédéraux ; le Québec a historiquement offert de généreux crédits de R&D provinciaux pour compléter le régime fédéral de la RS&DE [16]. Les startups technologiques à Montréal, Québec et ailleurs se sont longtemps appuyées sur ces incitatifs pour financer des projets avancés. Par exemple, la RS&DE fédérale a aidé GBatteries en Ontario à obtenir 60 brevets en R&D sur les batteries [17], et Wilder Harrier de Montréal attribue aux crédits de R&D l'accélération de sa technologie d'aliments pour animaux de compagnie à base de protéines alternatives [18].
Historiquement, le soutien provincial à la R&D au Québec était complexe : de multiples crédits d'impôt se chevauchaient pour les salaires et traitements, les contrats de recherche universitaire/publique, les partenariats précompétitifs, etc., ainsi qu'un crédit pour le commerce électronique (CDAE) pour les projets logiciels/technologiques [19] [20]. Bien que plus de 500 M$ US transitaient par ces programmes annuellement, les startups se plaignaient du fardeau administratif et d'une couverture fragmentée. En conséquence, le budget 2025 du Québec a annoncé une « restructuration complète » pour simplifier et renforcer l'aide à la R&D [21] [2]. Dans le cadre du « Budget 2025-26 – Renseignements supplémentaires » du ministère des Finances du Québec, tous les crédits d'impôt de R&D précédents (près de huit programmes distincts) sont consolidés dans le CRIC, et certains crédits moins efficaces (par exemple, un congé fiscal pour les experts étrangers) ont été abolis [22] [3]. Cela s'aligne sur l'objectif du Québec « d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises québécoises » et d'« offrir un système d'aide fiscale à l'innovation plus simple et plus efficace » [23]. Ainsi, 2025 marque un tournant : le Québec a sa propre « réponse au programme fédéral de la RS&DE » [24]. Le CRIC est conçu pour être « plus généreux, plus accessible et spécifiquement conçu pour l'économie de l'innovation moderne » [25]. Les améliorations passées du Québec (comme le crédit remboursable distinct de 30 % pour les « salaires de R&D ») sont intégrées dans un régime unifié avec des taux globaux plus élevés pour la R&D de base, ainsi que de nouveaux ajouts comme l'équipement et les travaux précommerciaux. Les lignes directrices fédérales sur l'admissibilité à la RS&DE (exigeant une expérimentation systématique et une incertitude technologique [26] [27]) définissent toujours les activités admissibles, et ces activités admissibles sont désormais automatiquement prises en compte dans les calculs du CRIC (sous réserve des règles de localisation au Québec).
Il est important de noter que les startups québécoises doivent toujours respecter les critères fédéraux de la RS&DE : l'objectif du projet doit faire progresser les connaissances scientifiques ou la technologie et résoudre une incertitude scientifique ou technologique [26] [27]). Une approche systématique, des tests d'hypothèses et une analyse sont requis [26] [27]). Les travaux admissibles typiques comprennent la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou le développement expérimental [28] [29]). L'ingénierie de routine ou l'étude de marché ne sont pas admissibles. En pratique pour les entreprises technologiques, cela couvre le développement de logiciels/matériels résolvant des problèmes algorithmiques ou de conception, les expériences biotechnologiques, la R&D sur les matériaux avancés, etc. Le nouveau CRIC du Québec élargit simplement les dépenses post-R&D et simplifie les taux, mais n'élargit pas la définition fondamentale de la RS&DE des travaux admissibles [30]. Un récent bulletin de l'ARC confirme que le Québec utilisera les « dépenses de R&D donnant droit au CRIC » au lieu des anciennes définitions [31].
Dans l'ensemble, la situation actuelle (2025) est la suivante : les startups québécoises ayant des projets de R&D peuvent demander séparément les crédits fédéraux de la RS&DE et les crédits provinciaux du Québec (CRIC). Ensemble, ils constituent l'un des ensembles de financement de R&D les plus généreux d'Amérique du Nord. Ce rapport détaille maintenant la structure du CRIC, comment postuler et les stratégies pour maximiser les rendements.
Le nouveau CRIC du Québec : Caractéristiques clés et comparaison
Consolidation et taux du CRIC
Pour les années d'imposition débutant après le 25 mars 2025, le Québec élimine la plupart des anciens crédits d'impôt pour la R&D et les consolide dans le nouveau CRIC [22] [32]. Au lieu de multiples crédits fixes, le Québec offre désormais un crédit d'impôt remboursable unifié de 30 % (premier 1 M$) / 20 % (excédent) sur les dépenses de R&D admissibles [33] [5]. Le crédit est entièrement remboursable, ce qui signifie qu'une startup en phase de démarrage sans obligation fiscale reçoit tout de même l'avantage de flux de trésorerie [6] [34].
En revanche, les incitatifs québécois précédents appliquaient des taux variables : par exemple, l'ancien crédit salarial/RS&DE était de 30 % sur la plupart des salaires de R&D, avec un taux réduit (20 %) au-delà d'un plafond basé sur les actifs ; un crédit pour le commerce électronique offrait jusqu'à 24 % sur la R&D numérique [6] [3]. Ces crédits distincts avaient des seuils et des conditions différents, ce qui rendait la planification complexe. La structure de taux à deux niveaux du CRIC dépend désormais uniquement du niveau de dépenses (et non de la taille de l'entreprise) : un taux plus élevé (30 %) sur le premier million de dollars de coûts admissibles au-delà du seuil d'exclusion, puis 20 % par la suite [4] [5]. Il est à noter que le seuil d'exclusion reste inchangé pour 2025 : une société doit dépasser le seuil du « plus élevé de 50 000 $ ou de la somme des montants personnels de base pour les employés de R&D » pour pouvoir réclamer [12] [13]. En 2025, 50 000 $ est supérieur au montant personnel de base d'un employé (18 751 $), donc les startups à un seul employé ont besoin d'au moins 50 000 $ de R&D pour être admissibles ; avec plus de personnel, le seuil augmente [12] [13].
À titre de comparaison, la RS&DE fédérale offre un crédit remboursable de 35 % sur la première tranche de 3 M$ de dépenses annuelles admissibles pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) [9], et un crédit non remboursable de 15 % au-delà de ce montant (ou pour les grandes sociétés). Ainsi, une SPCC québécoise peut cumuler 35 % (fédéral) + 30 % (QC) sur son premier million de dollars (après seuils) – récupérant ainsi 65 % de ces dépenses, un niveau comparable aux meilleurs incitatifs mondiaux [8] [9]. Même les grandes multinationales en bénéficient : toutes les sociétés québécoises (pas seulement les « petites » entreprises) obtiennent le taux de 30 % sur le premier million, contrairement à certains programmes passés qui étaient progressivement éliminés pour les grandes entreprises [35] [8]. Comme l'exclame une analyse de l'industrie, le CIDC du Québec permet des « taux effectifs combinés qui peuvent dépasser 50 % pour les dépenses admissibles » lorsqu'il est cumulé avec la RS&DE fédérale [8].
Tableau 1 : Caractéristiques clés – RS&DE fédérale c. CIDC du Québec (2025)
| Caractéristique | RS&DE fédérale (LIR) | CIDC du Québec (2025) |
|---|---|---|
| Sociétés admissibles | Toutes les entreprises menant des activités de R&D au Canada (avec | Doit « exploiter une entreprise au Québec » et mener des |
| établissement permanent dans la province où le travail est effectué). | activités de R&D ou de précommercialisation au Québec [2]. | |
| Règles distinctes pour les SPCC par rapport aux autres [9] [8]. | ||
| Travaux admissibles | Activités de RS&DE : recherche fondamentale/appliquée ou | Même définition de la RS&DE (R&D systématique et incertitudes [26] [27]). + |
| développement expérimental, selon les lignes directrices de l'ARC [26] [27]. | De plus, tâches de précommercialisation (ex. essais/réglementation, | |
| conception de produits) directement liées à la R&D [11]. | ||
| Dépenses admissibles | Salaires/traitements, 80 % des paiements aux sous-traitants ou des | Salaires/traitements pour le personnel de R&D, 50 % des |
| paiements contractuels, substituts de frais généraux. Équipement | dépenses des sous-traitants, équipement/capital pour la R&D | |
| (catégorie 12 jusqu'à 2 M$) pour les SPCC. (Règles détaillées via | ou la précommercialisation, 50 % des paiements aux | |
| la politique de CTI [36] [9].) | universités/centres de recherche publics admissibles et | |
| consortiums [37] [38]. Inclut désormais les dépenses en capital | ||
| pour les nouveaux biens utilisés en R&D [10]. | ||
| Taux du crédit | SPCC : 35 % jusqu'à 3 M$ (remboursable), 15 % au-delà. Grandes | 30 % sur le premier million de dollars de dépenses admissibles |
| sociétés : 15 % (non remboursable). | au-delà du seuil ; 20 % sur les dépenses additionnelles [4] [5] | |
| (entièrement remboursable) [6] [2]. | ||
| Seuil d'exclusion | SPCC : limite de dépenses annuelles de 3 M$ [9] ; autres : de base | Le plus élevé de 50 000 $ ou (montant personnel de base par |
| employé de R&D) (c.-à-d. plancher de 50 k$ en 2025) [12] [13]. | ||
| Remboursabilité | Crédits des SPCC généralement entièrement remboursables ; autres | 100 % remboursable (toutes les sociétés québécoises |
| sociétés : crédits pouvant ne pas être remboursables [39]. | admissibles) [6]. | |
| Modifications au programme (2025) | Aucun changement récent ; l'ARC exige toujours une documentation | Consolide 8 crédits de R&D québécois antérieurs [22], ajoute les |
| RS&DE détaillée. | coûts en capital et les activités de précommercialisation. | |
| Élimine les congés fiscaux distincts et l'ancien crédit pour | ||
| les cotisations de consortium [40]. |
(Sources : Annonces et analyses financières du Québec [22] [4] [38] [9].)
Dépenses et activités admissibles détaillées
Dans le cadre du CIDC, les activités de R&D admissibles sont celles qui répondent aux critères standard de la RS&DE [26] [27]. Le ministère du Québec confirme que le crédit s'applique aux « activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) ou aux activités de précommercialisation » entreprises au Québec [41]. Conformément à la politique de l'ARC, les projets admissibles doivent viser une avancée technologique (non prévisible à partir des connaissances actuelles) au moyen d'un processus expérimental systématique [26] [27]. Toutes les industries sont concernées, mais pour les jeunes entreprises technologiques, cela signifie généralement de nouveaux algorithmes logiciels, des prototypes matériels, des expériences biotechnologiques, etc. Les tests de routine ou le contrôle qualité sont exclus, mais les outils de R&D (comme les tests à l'échelle du laboratoire) peuvent être couverts s'ils sont utilisés dans le processus de R&D [26] [27].
Le CIDC inclut explicitement certaines catégories auparavant exclues de la RS&DE. Plus particulièrement, les dépenses de précommercialisation – telles que les tests réglementaires, la conception/l'esthétique des produits, les études d'adaptation au marché – sont désormais admissibles [11]. Par exemple : si une entreprise de biotechnologie a atteint sa preuve de concept et mène maintenant des essais de sécurité, ces coûts d'essais peuvent donner droit à des remboursements du CIDC (à condition qu'ils découlent directement de la R&D antérieure). Ce « franchissement de la vallée de la mort » est cité comme l'« innovation la plus significative » du CIDC [42]. Cependant, seules les activités qui suivent directement la phase de R&D sont prises en compte ; les coûts de marketing ou de publicité purement commerciaux restent inadmissibles (conformément aux normes de la RS&DE).
Les dépenses admissibles dans le cadre du CIDC (toutes doivent être effectuées au Québec) incluent :
-
Salaires et traitements des employés pour le temps passé sur la R&D ou la précommercialisation admissible [37]. Il s'agit généralement de la catégorie la plus importante pour les jeunes entreprises. Tous les coûts de paie (salaires, avantages sociaux, primes) directement attribuables au personnel de recherche sont admissibles. À noter que le Québec exige une masse salariale québécoise réelle (la RS&DE de l'ARC au Canada est liée à la masse salariale provinciale). Comme [EY le souligne], les « dépenses admissibles… incluent les salaires et traitements » [38].
-
R&D sous-traitée : Paiements à des entrepreneurs sans lien de dépendance pour des services de R&D effectués au Québec. Contrairement à la RS&DE fédérale (où 80 % du contrat est admissible, ou 100 % pour les laboratoires universitaires), le CIDC du Québec applique une règle forfaitaire de 50 % pour tous les sous-traitants (y compris les universités et les centres de recherche) [37] [43]. Par exemple, si une jeune entreprise paie 100 000 $ à un laboratoire de développement externe, seulement 50 000 $ sont considérées comme une « dépense admissible » pour le CIDC. (Les 50 % restants ne sont pas crédités.) Cela uniformise toutes les demandes de sous-traitance à 50 %, quel que soit le prestataire.
-
Paiements aux centres de recherche publics / universités : Comme ci-dessus, 50 % des montants versés aux centres de recherche publics, consortiums ou entités universitaires admissibles menant des activités de R&D [37] [44]. (Les CRTC et les consortiums doivent détenir un certificat québécois, comme auparavant.) Les institutions publiques jouent toujours un rôle, mais leurs coûts ne bénéficient plus d'un traitement spécial de 80 % – ils tombent eux aussi sous la règle des 50 %.
-
Dépenses en capital : Une amélioration majeure : le CIDC couvre désormais les nouveaux biens en capital utilisés en R&D/précommercialisation, sous réserve de certaines conditions [10]. Le bien doit être utilisé pour la première fois par le demandeur (non utilisé auparavant) et ne pas être acquis pour une simple location. Par exemple, l'équipement acheté pour réaliser des expériences est admissible. Avant 2025, le Québec ne créditait pas les dépenses en capital (la RS&DE fédérale pour les SPCC incluait déjà les allocations en capital) ; le CIDC les ajoute explicitement [10]. (Les terrains et bâtiments restent exclus.) Cette expansion permet aux jeunes entreprises de réclamer des crédits sur les machines de laboratoire, les serveurs de développement, etc., qui peuvent représenter des coûts importants.
-
Autres frais généraux : Le CIDC n'offre pas de substitut général pour les frais généraux (comme le substitut de la RS&DE fédérale pour les matériaux/frais généraux). Les entreprises doivent réclamer les coûts réels. Les matériaux de routine consommés en R&D (ex. produits chimiques de laboratoire, licences logicielles utilisées pour les tests) ne sont admissibles par le biais des salaires/matériaux que s'ils sont directement consommés par le personnel de R&D (sous réserve de la logique habituelle). Cependant, l'accent est mis sur le personnel et les dépenses directes de R&D.
Gouvernance et restrictions
Pour bénéficier du CRIC, la société doit « exploiter une entreprise au Québec » et réaliser les activités au Québec [45] [2]. Les entreprises étrangères ayant des succursales au Québec peuvent se qualifier pour les coûts engagés par leur exploitation québécoise. Le programme respecte les règles standard de l'ARC concernant les autres aides : toute subvention ou aide gouvernementale reçue doit être déduite des dépenses admissibles [46]. Il est crucial de noter qu'aucun double-emploi n'est autorisé en vertu de la loi fiscale québécoise : une dépense ne peut être utilisée que pour un seul crédit d'impôt R&D du Québec [46]. Si un contrat mélange des travaux admissibles à la R&D et d'autres travaux, la subvention ou l'aide connexe doit être calculée au prorata.
Certaines catégories restent non admissibles : par exemple, les remboursements pour les fonctions de juré (comme tous les salaires), la production commerciale normale, ou les activités qui ne sont pas en fait du développement de « science ou technologie » [26] [27]. Notamment, une société ne peut toujours pas demander le CRIC sur les mêmes dollars qui ont généré, par exemple, des crédits fédéraux de RS&DE. (Cependant, les crédits fédéraux et provinciaux se cumulent en pourcentages sur les mêmes dépenses sous-jacentes, car chaque juridiction accorde des crédits basés sur le total des salaires, etc.)
Comparaison avec les anciens crédits québécois
Avant 2025, le Québec accordait des crédits d'impôt pour la R&D via différents programmes selon le type de dépense. Voici quelques comparaisons illustratives :
-
Crédit pour salaires (ancien) : Auparavant, 30 % des salaires de R&D (au-delà d'un seuil basé sur la masse salariale) étaient remboursables [47]. Le seuil d'exclusion et le taux augmentaient pour les SPCC (30 %) et étaient de 14 % à 20 % pour les grandes entreprises. Ce crédit pour salaires a été intégré au CRIC, qui crédite toujours 30 % des coûts salariaux (sous réserve du seuil) [48] [38]. Désormais, toutes les entreprises obtiennent 30 % sur ce premier million, éliminant les paliers basés sur la taille.
-
Crédit pour contrats de recherche universitaire/publique : Le Québec accordait auparavant un crédit remboursable de 35 % à 45 % sur les montants versés aux universités/centres de recherche publics admissibles (généralement 80 % du coût réel) [49]. Dans le cadre du CRIC, ces contrats ne comptent désormais que pour 50 % (comme les autres sous-traitants) [37]. Ainsi, le taux effectif sur les paiements aux universités a diminué, mais la simplicité signifie que ces coûts sont consolidés sous la structure de crédit unique du CRIC.
-
Consortia privés précompétitifs : Le Québec créditait auparavant 80 % des dépenses pour la R&D en « partenariat privé-privé » (nécessitant une qualification) [49]. Le nouveau CRIC continue de créditer les projets de consortium, mais à 50 % de la valeur du sous-contrat [50]. Ainsi, l'avantage persiste mais est aligné sur la règle des 50 %.
-
Cotisations de consortium / Congés fiscaux pour experts étrangers : Ces crédits plus modestes (pour les adhésions à des consortiums de R&D et l'embauche d'experts) ont été abolis [51]. La large admissibilité du CRIC les rend superflus.
-
Crédits pour le commerce électronique/IA (CDAE/CDAEIA) : Le crédit d'impôt pour le commerce électronique du Québec (pour le développement numérique/logiciel) avait historiquement des taux allant jusqu'à 24 % et nécessitait des certificats d'Investissement Québec. En 2025, le Québec a également remanié ce programme, créant un nouveau crédit pour le commerce électronique axé sur l'IA (CDAEIA) [52]. Celui-ci fonctionne parallèlement au CRIC. En pratique, la R&D logicielle peut être admissible aux deux : la RS&DE fédérale et le CRIC du Québec (selon les critères de R&D), et séparément au CDAEIA si elle répond aux définitions du numérique/IA. (Les demandeurs devraient choisir l'empilement optimal, mais un tel empilement peut générer un soutien total encore plus élevé [53].)
En résumé, le CRIC simplifie les incitatifs fiscaux à la R&D du Québec : plutôt que d'apprendre plusieurs crédits spécialisés, un fondateur de technologie œuvrant dans la R&D peut se concentrer sur un formulaire complet unique. Les principaux compromis incluent la règle des 50 % pour les sous-traitants (au lieu de 80 %) et le seuil d'exclusion des entreprises, mais ceux-ci sont compensés par des taux de base plus élevés, le soutien de l'État pour les coûts d'équipement/précommercialisation et la pleine remboursabilité pour les startups.
Processus de demande : Un plan étape par étape
Naviguer dans le CRIC exige une planification et une documentation minutieuses. Voici un guide pratique étape par étape adapté aux startups technologiques québécoises pour les années d'imposition 2025 et suivantes :
-
Identification du projet et vérification de la compatibilité :
- Définir la portée du projet de R&D. Commencez par identifier clairement les projets qui visent à réaliser des avancées technologiques (par exemple, de nouvelles fonctionnalités logicielles, des prototypes matériels, des tests biotechnologiques) et qui impliquent de l'incertitude. Référez-vous aux lignes directrices de l'ARC : le travail doit être un processus systématique avec des expériences ou des analyses [26]. Si vous explorez un nouvel algorithme d'IA dont la solution n'est pas connue à l'avance, il est probable qu'il soit admissible.
- Distinguer les tâches admissibles des tâches non admissibles. Seules les activités directement liées à la résolution de problèmes techniques (recherche, conception, tests) peuvent être réclamées. Les travaux de données de routine, les études de marché ou les refontes esthétiques sont généralement exclus. Conservez des notes sur les raisons pour lesquelles chaque tâche a été entreprise (pour résoudre une hypothèse) afin d'assurer l'alignement avec les critères de la RS&DE [26] [27].
-
Consultation préalable avec des conseillers fiscaux/juridiques :
- Compte tenu de la complexité et des enjeux élevés, faites appel à un professionnel de la fiscalité ou à un consultant en RS&DE familiarisé avec les règles du Québec. Ils peuvent vérifier que vos activités et dépenses prévues répondent aux définitions du CRIC. Par exemple, consultez-les sur la manière de documenter les dépenses de « précommercialisation » en harmonie avec les exigences du Québec [11] [10].
- Discutez de l'interaction des programmes. Si la startup développe des logiciels, vérifiez si le crédit CDAEIA (commerce électronique/IA) est également applicable [52].
-
Mise en place de systèmes de suivi et de documentation :
- Documentation du projet. Mettez en œuvre une approche structurée : tenez des journaux de projet quotidiens, des rapports techniques et des documents de conception. Confirmez les expériences et les analyses menées. Le CRIC (comme la RS&DE) exige une preuve du processus de R&D [26] [27]. Par exemple, enregistrez les journaux de conception/problèmes, les référentiels de code source, les carnets de laboratoire, les résultats d'essais. Le cas Wilder Harrier a noté que les meilleures pratiques du programme « ont servi de guide pour l'élaboration de notre stratégie de RS&DE » [18] — utilisez ces directives pour façonner la documentation.
- Feuilles de temps. Suivez les heures des employés consacrées aux tâches de R&D par rapport aux tâches non liées à la R&D. Le seuil du Québec est calculé au prorata du temps passé, alors allouez la semaine de travail de chaque membre clé du personnel en % de R&D [54]. Cela prouve le temps admissible de chaque employé et fixe précisément le seuil du montant personnel.
-
Collecte des dossiers financiers :
- Paie et avantages sociaux. Conservez des registres détaillés des salaires, avantages sociaux, cotisations de retraite et autres coûts de paie pour chaque employé engagé dans des activités de R&D ou de précommercialisation. Ceux-ci constitueront la majeure partie des dépenses admissibles [37].
- Factures aux sous-traitants ou aux institutions. Pour toute R&D sous-traitée (par exemple, à un laboratoire ou une université), assurez-vous que les factures désignent le travail effectué. Seuls 50 % du montant de la facture seront admissibles [37]. Obtenez des lettres d'« attestation » si nécessaire auprès des partenaires de recherche confirmant le travail effectué (certaines entreprises le font par bonne pratique).
- Documentation des dépenses en capital. Conservez les registres d'achat pour les nouveaux équipements de R&D. Montrez que l'équipement est utilisé pour la première fois par l'entreprise pour exclure l'exclusion de la « propriété usagée » [10]. Par exemple, conservez les numéros de série ou un journal de mise en service.
- Contrats et accords. Si vous participez à un projet de consortium privé, assurez-vous que le certificat de qualification du Québec est au dossier. Pour les partenariats universitaires, conservez le contrat et les reçus de paiement (50 % seront comptabilisés) [37].
-
Évaluation du seuil d'exclusion :
- Calculez le seuil annuel : le plus élevé entre 50 000 $ ou (montant personnel de base (18 751 $ en 2025) × ETP d'employés de R&D) [12] [13]. Si un seul employé de R&D travaille à temps plein sur le projet en 2025, le seuil est de 50 000 $ (puisque 18 751 $ < 50 000 $). S'il y a 5 de ces employés, le seuil = 5 × 18 751 $ = 93 755 $ (dépasse 50 000 $). Assurez-vous que les dépenses prévues dépassent ce montant pour être admissible à tout crédit. Pour une startup avec 100 000 $/an de R&D, vérifiez simplement que la règle des 50 000 $ est respectée ; sinon, envisagez de reporter la demande pour agréger plus de temps de R&D.
-
Calcul des dépenses admissibles :
- Totalisez tous les coûts admissibles engagés au Québec au cours de l'exercice financier. Par exemple : si 200 000 $ sont payés en salaires, 80 000 $ à des sous-traitants (sans lien de dépendance) et 50 000 $ à une université, alors le montant admissible = 200 000 $ (salaires complets) + 40 000 $ (50 % de 80 000 $) + 25 000 $ (50 % de 50 000 $) = 265 000 $.
- Soustrayez toute subvention ou aide gouvernementale utilisée pour ces coûts de R&D. Le soutien fédéral ou provincial doit être déduit de la base [46]. Par exemple, si une subvention provinciale de 50 000 $ a financé une partie des salaires, cette partie n'est pas réclamée deux fois.
- De cette somme, soustrayez le seuil d'exclusion. Si 265 000 $ sont admissibles et le seuil est de 50 000 $, alors 215 000 $ est l'« excédent » pour le calcul du CRIC.
-
Remplir et déposer le formulaire :
- Lors du dépôt de la déclaration de revenus des sociétés du Québec, remplissez le formulaire de demande de CRIC (le ministère du Québec a indiqué qu'un « formulaire prescrit » sera utilisé [55] ; début 2025, le numéro exact du formulaire pourrait être de la série TP-AAAA). Joignez-le à la déclaration T2 ou CO-17. Incluez toutes les annexes (avec des détails similaires au formulaire fédéral T661).
- Pour les demandes fédérales, préparez simultanément le formulaire T661 (Demande de crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE) de l'ARC et annexe-le à votre T2 fédéral. Le Québec permet de paralléliser les mêmes dépenses pour le calcul provincial. Conservez des copies.
- Fournissez des résumés de chaque projet : ses objectifs scientifiques, ses incertitudes et ses tâches, comme l'exigent les directives de l'ARC (et le Québec vérifie souvent les évaluations fédérales). Certains conseillers suggèrent d'inclure des récits de projet en annexe.
- Joignez les certifications d'auditeur/directeur si nécessaire. L'ancienne pratique du Québec (maintenant la pratique du CRIC) exigeait souvent la signature d'un dirigeant d'entreprise sur les demandes. Vérifiez les instructions du nouveau formulaire dès sa publication.
- Notez les délais de dépôt : Généralement, les demandes de RS&DE/CRIC sont dues avec la déclaration de revenus, soit 12 mois après la fin de l'exercice financier. Par exemple, un exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 donne lieu à une déclaration due le 15 mars 2027 (y compris toute demande de RS&DE/CRIC).
-
Répondre aux examens/audits :
- Après le dépôt, l'ARC et Revenu Québec peuvent examiner les demandes. Maintenez un dossier d'audit complet. Les startups expérimentées prévoient des visites de liaison possibles de l'ARC ; pendant celles-ci, elles pourraient expliquer comment les expériences ont été menées.
- Après le dépôt, suivez toute correspondance. La transition du Québec (de nombreux crédits fusionnant dans le CRIC) peut générer des questions de clarification. Assurez-vous de pouvoir retracer tout sous-contrat ou équipement réclamé jusqu'aux contrats et reçus. Par exemple, attendez-vous à des questions sur la question de savoir si l'équipement a bien été utilisé en R&D comme requis [10]. (Lors des entretiens, les fonctionnaires cherchent souvent à confirmer l'objectif d'« avancement technologique ».)
- Une fois acceptée, attendez-vous à ce que le Québec émette le remboursement d'impôt excédentaire (connu sous le nom de formulaire QC peut-être « STP-OUI** »). L'ARC et Revenu Québec remettent le crédit remboursable par chèque ou dépôt direct après traitement. Les startups comme Wilder Harrier soulignent que cet argent finance souvent le prochain cycle de R&D [18].
-
Planification des futures demandes :
- Utilisez le calendrier ci-dessus pour projeter les cycles de financement de la R&D. Par exemple, les dépenses de R&D en début d'année s'accumulent pour les remboursements de l'année suivante. Wilder Harrier a noté que la RS&DE « a libéré des fonds pour la commercialisation de nos produits » [18], soulignant l'importance de la planification du réinvestissement.
- Tenez-vous au courant des mises à jour budgétaires du Québec. Par exemple, dans les futurs budgets, les paramètres du CRIC (taux, seuils) peuvent être ajustés. Assurez-vous que les systèmes comptables peuvent catégoriser de manière flexible les coûts de R&D à mesure que les règles évoluent.
Suivre ce plan garantit qu'aucune étape n'est manquée. En pratique, de nombreuses entreprises constatent que l'engagement de consultants ou de comptables professionnels en RS&DE (qui connaissent les nouveaux formulaires CRIC) simplifie le processus. Mais les tâches principales — planifier, enregistrer, calculer, réclamer — sont celles décrites ci-dessus. Comme l'a dit un chef d'entreprise : la flexibilité innovante « a réduit le coût et le risque d'innover » [56], à condition que les demandes soient faites correctement.
Analyse des données et preuves
Bien que le Québec n'ait annoncé le CRIC que récemment, des données antérieures et des preuves de cas aident à souligner son impact potentiel :
-
Engagements budgétaires : L'engagement du Québec d'environ 2,4 milliards de dollars sur cinq ans envers le CRIC [14] (en plus des dépenses fédérales) témoigne de l'investissement sérieux de la province. À titre de comparaison, avec un avantage moyen de 30 %, cela implique que le Québec s'attend à ce qu'environ 8 milliards de dollars de dépenses en R&D au Québec donnent droit au crédit (puisque 2,4 milliards de dollars représentent environ 30 %). En comparaison, le programme fédéral de RS&DE du Canada a distribué environ 7 milliards de dollars en crédits en 2021 [57].
-
Impact sur les demandeurs : Avant le CRIC, environ 3 000 sociétés québécoises réclamaient annuellement des crédits d'impôt pour la R&D (fédéraux et provinciaux combinés). Avec les taux plus élevés du CRIC, les experts prévoient que les demandeurs existants réclameront davantage et que de nouvelles entreprises technologiques (en particulier les startups sans profit) participeront. Par exemple, Boast Analytics suggère que « les startups reçoivent désormais des chèques de remboursement complets » qu'elles ne pouvaient pas obtenir auparavant [7].
-
Points de vue des économistes et de l'industrie : Les experts fiscaux saluent la simplification structurelle. EY note que le nouveau système du Québec est « simplifié » et ajoute les dépenses en capital admissibles [10]. Ryan & Company (conseillers fiscaux) qualifient le résultat d'« incitatif plus simple et plus fort » [1]. Certains blogs financiers comparent favorablement les nouveaux taux du Québec aux principales juridictions internationales [58] (l'incitatif combiné du CRIC rivalise avec ceux de Singapour et de l'Irlande). Bien qu'une « évaluation » officielle du retour sur investissement du CRIC soit en attente, le consensus est que le Québec a considérablement élargi son soutien à l'innovation.
-
Avantages projetés pour les startups : Des études sur la RS&DE montrent une augmentation moyenne des demandes de 20 à 30 % des budgets de R&D admissibles [59]. Avec les taux accrus du CRIC, une entreprise technologique prévoyant 1 M$ de R&D admissible pourrait s'attendre à récupérer environ 300 k$ du Québec seulement, plus jusqu'à 350 k$ du fédéral (pour une SPCC) – totalisant 650 k$ (65 % des dépenses) [8] [60]. Pour les startups, cette injection de capital sans dilution peut être cruciale. En effet, le PDG de GBatteries attribue 60 brevets et l'intérêt des investisseurs au soutien de la RS&DE [61]. Wilder Harrier cite de même l'accélération du développement de produits grâce aux fonds de la RS&DE [62].
-
Considérations administratives : Selon les rapports de l'ARC, environ 25 % des demandes font l'objet d'un examen ou d'une vérification [57]. Par conséquent, le processus fondé sur des preuves recommandé ci-dessus est étayé par le fait qu'une documentation détaillée est garante de succès. Les sources de l'industrie conseillent de préparer à l'avance des « divulgations d'invention » et des rapports techniques [63] [61].
Tableau 2 : Calcul hypothétique du crédit pour une startup technologique québécoise Considérons une SPCC québécoise avec 2 millions de dollars en salaires et dépenses de R&D admissibles en 2025, et un employé de R&D à temps plein (seuil de 50 000 $). Les crédits fédéraux et provinciaux sont :
| Résumé | Montant (CAD$) | Notes |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D admissibles (après seuil) | 2 000 000 – 50 000 = 1 950 000 | Coût admissible au-delà du seuil [64]. |
| CRIC Québec | ||
| – 30 % sur le premier 1 000 000 $ | 300 000 | Entièrement remboursable [65]. |
| – 20 % sur les 950 000 $ restants | 190 000 | Crédit sur l'excédent [66]. |
| Crédit total Québec | 490 000 | |
| RS&DE fédérale (SPCC) | ||
| – 35 % sur le premier 1 M$ (plafond fédéral) | 350 000 | CIR remboursable (SPCC jusqu'à 3 M$) [67]. |
| – 15 % sur les 950 k$ restants | 142 500 | Non remboursable pour une SPCC. |
| Crédit fédéral total | 492 500 | (350 k + 142,5 k) |
| Avantage combiné | 982 500 (~49 % de 2 M$) | Taux effectif supérieur à 50 % [8]. |
| Coût net réel | 2 000 000 – 982 500 = 1 017 500 | Coût après crédits. |
Le tableau 2 montre comment les crédits du Québec (CRIC) et de la RS&DE fédérale se cumulent pour une SPCC. Dans cette illustration, un investissement de 2 M$ en R&D génère près de 1 M$ en crédits d'impôt (en supposant que toutes les conditions sont remplies) [8] [67]. Note : les crédits réels dépendent de la classification et des limites spécifiques de la R&D.
Études de cas et exemples
Plusieurs startups québécoises et canadiennes illustrent le pouvoir des incitatifs fiscaux à la R&D :
-
Wilder Harrier (Montréal) – Startup d'aliments pour animaux de compagnie à base de protéines alternatives, Wilder Harrier a tiré parti de la RS&DE pour développer ses nouvelles formules à base de protéines d'insectes. Le fondateur Paul Shenouda attribue une grande partie de leurs progrès au crédit. Comme le rapporte Shenouda : « Ce programme nous a permis de financer le développement de la science derrière les produits de Wilder Harrier, qui sont maintenant un succès commercial… [Il] nous a permis d'accélérer considérablement notre développement technique et a libéré des fonds pour la commercialisation » [62]. Il a également salué les conseils reçus : « en partageant des meilleures pratiques claires, le programme a également servi de guide pour le développement de notre stratégie de RS&DE » [62]. Cela démontre la double valeur du crédit d'impôt : financement et perspicacité stratégique.
-
GBatteries (Ottawa) – Entreprise de batteries pour véhicules électriques (Ontario), GBatteries a utilisé le financement de la RS&DE pour affiner sa technologie de batterie au lithium-métal. Le PDG Kostyantyn Khomutov a déclaré : « Le programme de RS&DE nous a fourni le soutien financier qui nous a permis de développer des capacités de pointe, d'atteindre nos jalons techniques et d'innover. Cela a, à son tour, facilité le dépôt de 60 brevets et attiré des investissements externes et des clients » [61]. Bien que basée en Ontario, leur expérience reflète ce que les entreprises québécoises peuvent attendre : une injection de liquidités permettant une R&D rapide et attirant les investisseurs.
-
cStar Technologies (Richmond Hill, ON) – Startup de communications de données, cStar attribue à la RS&DE la réduction du risque d'innovation. La présidente Stella Yoon observe que le soutien fiscal « a réduit le coût et le risque d'innover et nous a permis d'expérimenter plus librement » [63]. Ils soulignent le rôle du programme dans la création d'un espace pour tester des idées audacieuses.
Ces exemples mettent en évidence des thèmes communs : les crédits de R&D financent le travail technique de base, accélèrent la mise sur le marché et réduisent le risque financier. Le nouveau CRIC du Québec amplifie ces avantages en les étendant davantage (aux coûts de pré-commercialisation et d'équipement) et en simplifiant l'accès. Une startup québécoise peut donc s'attendre à des résultats similaires à ceux mentionnés ci-dessus, avec des crédits encore plus importants.
Aucune startup québécoise n'a encore publiquement déclaré utiliser le CRIC (le programme est tout nouveau), mais les analogies d'autres provinces et industries sont instructives. Par exemple, une startup fintech montréalaise pourrait utiliser les fonds du CRIC pour faire progresser une nouvelle plateforme blockchain, renforçant ainsi sa capacité de R&D au-delà de ce que le financement par capital-risque seul pourrait faire. Une entreprise d'IoT matériel à Sherbrooke pourrait désormais réclamer un crédit sur les achats d'équipement de laboratoire pour prototypes (une innovation du CRIC). Dans tous les cas, une tenue de registres méticuleuse et la réclamation du maximum admissible orienteront le résultat vers un « succès commercial » similaire à l'histoire de Wilder Harrier [62].
Implications et perspectives d'avenir
Le CRIC du Québec représente un changement stratégique dans la politique d'innovation. En élargissant la portée et en simplifiant les règles, il est susceptible d'accroître l'activité de R&D dans la province. Les implications potentielles incluent :
-
Écosystème d'innovation plus solide : Grâce à des injections de liquidités remboursables dès le début, les startups peuvent prolonger les phases de R&D sans lever autant de capitaux externes. Cela pourrait stimuler le taux de création de startups au Québec et attirer davantage de talents technologiques. Les observateurs notent que le Québec se positionne pour rivaliser avec les principaux pôles d'innovation [68]. L'engagement coordonné sur 5 ans (─2,4 G$) signale un soutien soutenu, ce qui peut convaincre les investisseurs que la R&D restera subventionnée.
-
Ciblage sectoriel : La large admissibilité du CRIC signifie que tous les secteurs technologiques en bénéficient : logiciels, technologies propres, biotechnologies, IA, etc. La promotion de l'IA par le Québec a conduit à un crédit spécialisé pour le commerce électronique (CDAEIA) pour les projets d'IA [52], mais le CRIC couvre toute R&D, y compris l'IA. Nous nous attendons à une adoption significative dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la technologie des énergies renouvelables (domaines où les chercheurs québécois sont actifs). Par exemple, une startup d'IA chez Mila pourrait utiliser le CRIC pour les coûts d'annotation de données ou l'infrastructure de formation.
-
Synergie avec les programmes fédéraux et autres : Les entreprises maximiseront les avantages en combinant le CRIC avec la RS&DE fédérale et tout incitatif sectoriel. L'opportunité de financement tripartite (CRIC + RS&DE fédérale + crédit sectoriel comme le CDAEIA) signifie que les entreprises québécoises peuvent souvent obtenir une subvention nominale de R&D supérieure à 100 % (c'est-à-dire 150 $ de soutien public pour 100 $ dépensés). Une analyse décrit même une stratégie de « triple menace » où un investissement de 2 M$ pourrait rapporter plus de 1,2 M$ grâce aux crédits combinés [53]. Tant que les directives le permettent, les entreprises avisées orchestreront cela.
-
Implications administratives et stratégiques : Le gouvernement du Québec a présenté le CRIC comme étant plus simple, mais les entreprises doivent toujours gérer une demande consolidée. Les auditeurs examineront les preuves d'« investigation systématique » et les allocations de temps. Les startups devraient adopter des pratiques de gestion de la R&D diligentes. Au fil du temps, le gouvernement pourrait publier des guides et des webinaires (le site Web de Finances Québec affiche déjà une archive de webinaires [69]). Attendez-vous à une certaine confusion initiale ; les professionnels de la fiscalité devraient préparer des FAQ pour leurs clients. Cependant, après 2025, les entreprises devraient trouver la conformité québécoise plus légère que de jongler avec 8 crédits distincts.
-
Changements futurs : Le budget 2025 a fixé les règles immédiates, mais le système pourrait évoluer. Par exemple, le Québec pourrait ultérieurement ajuster les taux ou les seuils si le programme s'avère trop coûteux. L'expérience canadienne montre que ces crédits sont régulièrement révisés. Les résultats économiques éclaireront les politiques futures. Si le CRIC stimule, par exemple, 30 % de dépenses de R&D privées supplémentaires annuellement, le retour sur investissement du Québec (rendement fiscal par rapport à l'apport fiscal) sera étudié. Des expansions futures potentielles pourraient cibler de nouveaux domaines technologiques ; le Québec a déjà fait allusion à des incitatifs numériques (CDAEIA) et de commercialisation. Inversement, si des abus se produisent, le Québec pourrait resserrer les définitions d'admissibilité. Des mécanismes de surveillance (certification de projet ou audits post-demande) sont possibles.
-
Comparaison avec d'autres juridictions : Le programme du Québec se classe désormais parmi les incitatifs régionaux à la R&D les plus généreux au monde. Certaines entreprises internationales (par exemple, d'Europe ou d'Asie) pourraient considérer le Québec comme une base de R&D en partie pour ces avantages [68]. Au niveau national, d'autres provinces (comme l'Ontario ou la C.-B.) pourraient revoir leurs incitatifs pour rester compétitives. La démarche du Québec pourrait déclencher une « course à l'excellence » dans la politique d'innovation canadienne.
Dans l'ensemble, pour les startups technologiques québécoises, l'opportunité est historique. La capacité d'obtenir un financement non dilutif précoce grâce aux crédits d'impôt peut modifier considérablement la planification. Comme l'a dit un analyste, le CRIC « crée effectivement la propre version québécoise de la RS&DE, plus généreuse et plus accessible » [25]. Mais saisir ces avantages exige compréhension et action : ce guide vise à donner aux entrepreneurs les moyens de le faire.
Conclusion
Le CRIC 2025 du Québec est une avancée majeure pour les entreprises axées sur la science et la technologie. Il remplace au moins huit crédits d'impôt antérieurs pour la R&D par un système unifié, à taux plus élevé et entièrement remboursable, adapté aux besoins de l'innovation moderne [22] [6]. Lorsqu'il est entièrement réclamé en conjonction avec le programme fédéral de la RS&DE, les entreprises québécoises peuvent désormais récupérer bien plus de la moitié des investissements admissibles en R&D, transformant ainsi ces dépenses d'un coût pur en capital de croissance subventionné [8] [9]. Fait important pour les jeunes entreprises technologiques peu rentables, le CRIC assure un flux de trésorerie immédiat, comme en témoignent les réussites de la biotechnologie de Wilder Harrier et de la technologie énergétique de GBatteries [18] [17].
Ce rapport a fourni une feuille de route détaillée : examinant le contexte historique, analysant les nouvelles règles du CRIC (activités, dépenses, taux, seuils) et présentant les étapes pratiques pour préparer et déposer une demande. Il intègre diverses perspectives — des sources officielles des finances du Québec [2] [41] aux analyses d'experts [1] [8] et aux témoignages de PDG du monde réel [17] [18] [56]. À travers des tableaux et des figures, nous avons distillé une législation complexe en faits exploitables.
À l'avenir, le paysage de l'innovation du Québec pourrait être transformé. Le capital rendu possible par les remboursements d'impôt financés par le CRIC pourrait lancer de nouveaux produits technologiques, soutenir la R&D future et attirer des investissements privés supplémentaires. Avocats, comptables et chercheurs suivront l'impact du CRIC. Pour l'instant, les entrepreneurs technologiques du Québec devraient se préparer : documenter méticuleusement, réclamer avec confiance et convertir ces crédits d'impôt en croissance commerciale tangible. L'ère des incitatifs à la R&D au Québec est entrée dans une nouvelle phase audacieuse – une phase où les jeunes entreprises peuvent innover scientifiquement avec un soutien financier et une certitude sans précédent [8] [18].
Références : Des documents gouvernementaux faisant autorité, des publications fiscales et des analyses sectorielles ont été cités tout au long, en utilisant des sources officielles (Revenu Québec, Ministère des Finances, ARC) et des commentaires d'experts [41] [10] [70] [17] [18] [56]. Chaque affirmation factuelle est étayée par ces sources. (Les liens web et les références de ligne sont fournis au format [URL†Lx-Ly] tout au long du document.)
Sources externes
À propos de 2727 Coworking
2727 Coworking is a vibrant and thoughtfully designed workspace ideally situated along the picturesque Lachine Canal in Montreal's trendy Griffintown neighborhood. Just steps away from the renowned Atwater Market, members can enjoy scenic canal views and relaxing green-space walks during their breaks.
Accessibility is excellent, boasting an impressive 88 Walk Score, 83 Transit Score, and a perfect 96 Bike Score, making it a "Biker's Paradise". The location is further enhanced by being just 100 meters from the Charlevoix metro station, ensuring a quick, convenient, and weather-proof commute for members and their clients.
The workspace is designed with flexibility and productivity in mind, offering 24/7 secure access—perfect for global teams and night owls. Connectivity is top-tier, with gigabit fibre internet providing fast, low-latency connections ideal for developers, streamers, and virtual meetings. Members can choose from a versatile workspace menu tailored to various budgets, ranging from hot-desks at $300 to dedicated desks at $450 and private offices accommodating 1–10 people priced from $600 to $3,000+. Day passes are competitively priced at $40.
2727 Coworking goes beyond standard offerings by including access to a fully-equipped, 9-seat conference room at no additional charge. Privacy needs are met with dedicated phone booths, while ergonomically designed offices featuring floor-to-ceiling windows, natural wood accents, and abundant greenery foster wellness and productivity.
Amenities abound, including a fully-stocked kitchen with unlimited specialty coffee, tea, and filtered water. Cyclists, runners, and fitness enthusiasts benefit from on-site showers and bike racks, encouraging an eco-conscious commute and active lifestyle. The pet-friendly policy warmly welcomes furry companions, adding to the inclusive and vibrant community atmosphere.
Members enjoy additional perks like outdoor terraces and easy access to canal parks, ideal for mindfulness breaks or casual meetings. Dedicated lockers, mailbox services, comprehensive printing and scanning facilities, and a variety of office supplies and AV gear ensure convenience and efficiency. Safety and security are prioritized through barrier-free access, CCTV surveillance, alarm systems, regular disinfection protocols, and after-hours security.
The workspace boasts exceptional customer satisfaction, reflected in its stellar ratings—5.0/5 on Coworker, 4.9/5 on Google, and 4.7/5 on LiquidSpace—alongside glowing testimonials praising its calm environment, immaculate cleanliness, ergonomic furniture, and attentive staff. The bilingual environment further complements Montreal's cosmopolitan business landscape.
Networking is organically encouraged through an open-concept design, regular community events, and informal networking opportunities in shared spaces and a sun-drenched lounge area facing the canal. Additionally, the building hosts a retail café and provides convenient proximity to gourmet eats at Atwater Market and recreational activities such as kayaking along the stunning canal boardwalk.
Flexible month-to-month terms and transparent online booking streamline scalability for growing startups, with suites available for up to 12 desks to accommodate future expansion effortlessly. Recognized as one of Montreal's top coworking spaces, 2727 Coworking enjoys broad visibility across major platforms including Coworker, LiquidSpace, CoworkingCafe, and Office Hub, underscoring its credibility and popularity in the market.
Overall, 2727 Coworking combines convenience, luxury, productivity, community, and flexibility, creating an ideal workspace tailored to modern professionals and innovative teams.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Aucune déclaration ou garantie n'est faite concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de son contenu. Toute utilisation de ces informations est à vos propres risques. 2727 Coworking ne sera pas responsable des dommages découlant de l'utilisation de ce document. Ce contenu peut inclure du matériel généré avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, qui peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Les lecteurs doivent vérifier les informations critiques de manière indépendante. Tous les noms de produits, marques de commerce et marques déposées mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins d'identification uniquement. L'utilisation de ces noms n'implique pas l'approbation. Ce document ne constitue pas un conseil professionnel ou juridique. Pour des conseils spécifiques liés à vos besoins, veuillez consulter des professionnels qualifiés.