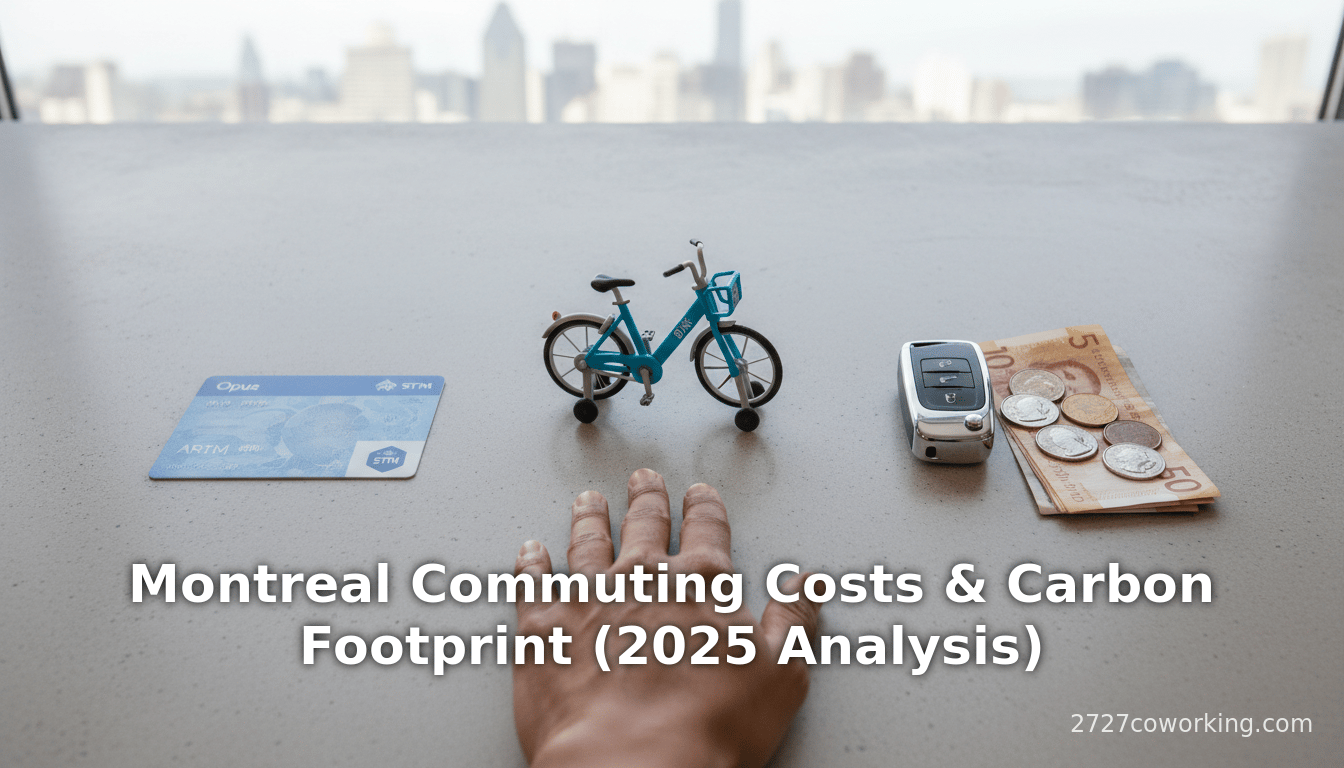
Coûts et empreinte carbone des déplacements à Montréal (Analyse 2025)
Résumé analytique
Ce rapport fournit une analyse détaillée des déplacements domicile-travail à Montréal en 2025, en se concentrant sur les coûts financiers et l'empreinte carbone des trois principaux modes de déplacement de la ville : le Métro, le vélo et l'automobile privée. Nous compilons et comparons des données actualisées sur les tarifs, les coûts de possession de véhicules, les infrastructures et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les principales conclusions sont les suivantes :
-
Comparaison des coûts : Un usager des transports en commun montréalais paie environ 100 $ par mois pour un abonnement mensuel illimité Métro/bus (Source: www.artm.quebec) (≈1 200 $/an). En revanche, un ménage canadien moyen dépense de l'ordre de 5 500 $ par an pour posséder et faire fonctionner une voiture typique (incluant le carburant, l'entretien, l'assurance, la dépréciation, etc.) [1]. Le vélo entraîne des coûts bien inférieurs : une dépense annuelle modeste pour un vélo personnel (de l'ordre de quelques centaines de dollars, amortis) et même un abonnement BIXI à 23 $/mois [2] (≈276 $/an), qui couvre des trajets pratiquement illimités.
-
Empreinte carbone : Étant donné que la majeure partie de l'électricité du Québec provient de l'hydroélectricité propre, le Métro de Montréal est pratiquement à zéro émission par passager-kilomètre. Des études estiment que les déplacements en Métro n'émettent qu'environ 0,015 kg de CO₂ par km [3] (≈15 g/km), tandis qu'une voiture à essence émet environ 0,12 à 0,18 kg de CO₂ par km [3]. L'empreinte opérationnelle du vélo est essentiellement nulle ; l'amortissement de la fabrication du vélo sur sa durée de vie donne de l'ordre de 20 à 50 g de CO₂ par km [4]. En termes pratiques, un aller-retour de 20 km en voiture émettrait environ 2,4 kg de CO₂, comparé à seulement ≈0,3 kg via le Métro électrique [3] – une économie d'environ 2,1 kg par trajet (≈210 kg par an pour 100 allers-retours) [5].
-
Parts modales et tendances : Les navetteurs montréalais utilisent majoritairement la voiture : le recensement de 2021 a indiqué que ~75 à 76 % des travailleurs se déplacent en voiture (en tant que conducteur ou passager) [6]. Seulement environ 15 % utilisaient les transports en commun et 7 à 8 % utilisaient les modes actifs (marche ou vélo) en 2021 [6]. Cependant, les enquêtes sur les déplacements post-pandémie montrent un rebond de la part des transports en commun (~21 % des trajets domicile-travail en mai 2024 [7]) et le vélo/la marche augmentant à ~8,3 % [8]. La Ville et les planificateurs régionaux ont fixé des objectifs ambitieux (par exemple, 50 % des déplacements par les transports en commun/modes actifs d'ici 2050 [9]) ce qui nécessitera des changements encore plus importants.
-
Contexte politique : Le transport routier est la principale source de GES à Montréal (≈43 % des émissions de la ville) [10]. Les plans municipaux et régionaux mettent l'accent sur les transports actifs et en commun plutôt que sur les voitures (par exemple, électrifier entièrement les bus d'ici 2040 et doubler l'utilisation des transports en commun [11]). Les experts notent que des obstacles structurels et culturels subsistent : la forme urbaine et les habitudes favorisent les voitures [12], et les usagers surestiment souvent l'impact environnemental des transports en commun [13].
Dans l'ensemble, les preuves favorisent fortement le Métro ou le vélo par rapport aux déplacements en voiture, tant pour l'efficacité économique que pour le climat. Le reste de ce rapport présente le contexte général, l'analyse des données et les études de cas qui étayent ces conclusions, avec des citations complètes des statistiques officielles et des recherches.
Introduction et Contexte
Montréal, la deuxième plus grande ville du Canada (population de l'île ~1,9 million en 2021, RMR ~4 millions), est depuis longtemps confrontée à l'équilibre entre la mobilité, les coûts fiscaux et l'impact environnemental. La ville a construit son Métro sur pneus pour l'Expo 67 et a depuis développé un vaste réseau de transports en commun et de pistes cyclables. En 2025, Montréal exploite 4 lignes de Métro (verte, orange, jaune, bleue) avec des centaines de stations, un vaste réseau de bus (STM) et un système de vélos en libre-service (BIXI) disponible toute l'année. Dans le même temps, la plupart des navetteurs dépendent encore de la voiture. Les objectifs climatiques officiels de la Ville – la carboneutralité d'ici 2050 – exigent des réductions drastiques des émissions de transport [10]. L'atteinte de ces objectifs dépendra d'un changement des habitudes de déplacement vers des modes plus écologiques.
Contexte des émissions du transport : À Montréal, le transport routier est la plus grande source de gaz à effet de serre. Le rapport climatique de la Ville indique que 43 % des émissions totales de GES de Montréal proviennent des véhicules routiers [10]. (En revanche, l'électricité du Québec est ~98-99 % hydroélectrique, ce qui signifie que les transports en commun et les véhicules électriques ne génèrent presque pas de CO₂ à l'échappement.) Les choix de déplacement jouent donc un rôle démesuré dans les budgets carbone municipaux. La Ville a fixé des objectifs concrets – par exemple, électrifier l'ensemble du parc d'autobus de la STM d'ici 2040 et développer des quartiers « zéro émission » qui réduisent de moitié les émissions routières [11]. Cependant, détourner des millions de trajets de la voiture est un défi. Des sondages montrent que la plupart des Montréalais sous-estiment les avantages environnementaux des transports en commun : une étude récente a révélé que les usagers jugeaient souvent (à tort) le Métro plus polluant que les voitures [13]. Cette perception erronée souligne la nécessité de disposer de données claires sur les coûts et les empreintes réels.
Comportement de déplacement : Selon les données de Statistique Canada et de la Ville, la répartition modale de Montréal reste dominée par la voiture. Le recensement de 2021 (« Trajet domicile-travail ») a indiqué que 71,0 % des navetteurs employés se rendaient au travail en voiture ou en camion, plus 4,6 % en tant que passagers – soit un total d'environ 76 % en voiture [6]. Seulement environ 15,3 % utilisaient les transports en commun (bus ou Métro) et 7,5 % marchaient ou faisaient du vélo [6]. (Remarque : le « transport actif » comprend la marche et le vélo.) Les enquêtes post-pandémie montrent que ces chiffres évoluent : en mai 2024, 21,3 % étaient des usagers des transports en commun (presque de retour au niveau de 2016 de 22,4 %) [7], et la marche/le vélo a augmenté à 8,3 % (contre 7,2 % en 2016) [8]. Cependant, ces enquêtes se réfèrent à l'ensemble de la province de Québec et peuvent agréger Montréal avec les villes voisines ; des enquêtes municipales à plus petite échelle suggèrent que la part des transports en commun à Montréal même approche les 20-25 %. Néanmoins, les voitures représentent toujours la majeure partie des déplacements domicile-travail. La congestion, la rareté du stationnement et la pollution de l'air sont des problèmes récurrents – même si les voitures entraînent des coûts très élevés pour les propriétaires et la société.
Coûts des déplacements : Les déplacements imposent des coûts monétaires directs aux travailleurs et aux gouvernements, ainsi que des coûts indirects (dommages routiers, pollution, temps). À Montréal, une enquête de 2024 révèle qu'un véhicule canadien moyen coûte 5 497 $ par an à posséder et à faire fonctionner [1]. Les conducteurs typiques dépensent environ 14 % du revenu du ménage pour les voitures [14]. En revanche, un abonnement mensuel de Métro coûte 100 $ (Source: www.artm.quebec) (zone A, toute la ville), ce qui représente ~1 200 $ par an même s'il est utilisé tous les jours. Le vélo entraîne des coûts courants minimes : mis à part l'achat ponctuel du vélo et les réparations occasionnelles, rouler est essentiellement un carburant gratuit. Le système de vélos en libre-service de Montréal (BIXI) offre des trajets courts illimités pour 23 $/mois [2].
Ce rapport examine ensuite chaque mode en profondeur. Nous présentons l'infrastructure actuelle et les statistiques d'utilisation, puis détaillons les coûts financiers (tarifs, carburants, entretien, etc.) et les émissions de carbone (par km et par trajet). Dans la mesure du possible, nous utilisons des chiffres et des études concrets récents. Nous examinons également les facteurs qualitatifs (par exemple, la saisonnalité, la sécurité, la congestion) et le contexte politique. Enfin, nous comparons des scénarios et des études de cas, et discutons des implications pour les objectifs de durabilité de Montréal.
Infrastructures et habitudes de déplacement à Montréal
Aperçu du réseau et des services
-
Métro (STM) : Le Métro de Montréal a ouvert en 1966 et compte maintenant quatre lignes sur pneus desservant l'île et une partie de Laval. Il transporte ~1 million de passagers par jour de semaine (niveaux pré-pandémiques) sur 68 stations [15]. Le système est entièrement électrifié. De plus, des dizaines de lignes de bus comblent les lacunes. Les tarifs (dans le système unifié de l'ARTM) sont de 3,50 $ par billet ou 100 $ pour un abonnement mensuel (adulte, toutes zones) (Source: www.artm.quebec). Le Plan de développement durable de la STM vise une réduction drastique des émissions : par exemple, 100 % des bus seront à zéro émission d'ici 2040 [11].
-
Bus et REM : Le réseau de trains de banlieue (maintenant sous la marque ARTM/Exo) et la nouvelle ligne de train léger REM desservent également les navetteurs régionaux ; cependant, notre objectif ici est le Métro vs vélo vs voiture, nous omettons donc une analyse détaillée des trains de banlieue. De nombreux Montréalais dépendent déjà des métros/bus, et plusieurs lignes du REM (par exemple, centre-ville-Rive-Sud) sont en construction ou en exploitation (à partir de 2023) pour augmenter la part des transports en commun.
-
Vélos : Montréal possède l'un des plus grands réseaux cyclables d'Amérique du Nord. La ville revendique un réseau totalisant environ 1 083 km de pistes cyclables (pistes protégées, sentiers, etc.) couvrant l'île [16] (les cartes de Vélo-Québec listent des milliers de km en incluant les villes voisines [17]). Ces dernières années, Montréal a rapidement étendu son réseau cyclable (plus de 1000 km d'ici 2020 [18]) et envisage maintenant un réseau de pistes cyclables « express » (RÉV) de 185 km de voies protégées [19]. Montréal est également réputée pour son soutien au cyclisme toute l'année : pistes déneigées et même vélos BIXI adaptés à l'hiver. Le programme BIXI (lancé en 2009) exploite désormais ~934 stations d'accueil et ~11 000 vélos (dont 2 600 vélos électriques) [20], avec une fréquentation record (13 millions de trajets en 2024 [21]).
-
Voitures privées : Le réseau routier de Montréal comprend des autoroutes majeures sur l'île (Autoroutes 15, 40, 20, etc.) et des milliers de kilomètres de rues urbaines. Le stationnement est limité et coûteux au centre-ville. Le déplacement en voiture offre une commodité de porte-à-porte, mais est confronté à des retards dus à la congestion. La possession de voitures est répandue : officiellement, l'île de Montréal comptait plus de 1,3 million de véhicules immatriculés en 2021 (données de StatCan) [22]. Les stratégies récentes de la ville visent explicitement à freiner l'utilisation de la voiture : par exemple, convertir de grands parkings en espaces verts, désigner des zones de véhicules électriques au centre-ville et réduire les exigences en matière de stationnement.
Demande et modes de déplacement
Répartition modale
Selon le recensement du Canada de 2021, parmi les 1,57 million de navetteurs de Montréal (travailleurs ayant un lieu de travail fixe), 71,0 % se sont rendus au travail en voiture ou en camion et 4,6 % en tant que passagers [6] (total ~76 % en auto). Seulement 15,3 % ont utilisé les transports en commun (bus ou Métro) et 7,5 % ont utilisé les modes actifs (marche ou vélo) [6]. Les ~1,6 % restants ont utilisé d'« autres » méthodes (moto, taxi, etc.) [6].
Il est à noter que ce recensement a eu lieu en mai 2021, alors que les taux de télétravail liés à la pandémie étaient encore élevés. Des données plus récentes de l'Enquête sur la population active (mai 2024) montrent un rebond de l'utilisation des transports en commun : environ 21,3 % des navetteurs de la région de Montréal utilisent désormais les transports en commun (contre 22,4 % en 2016) [7], et la marche/le vélo a augmenté à 8,3 % (contre 7,2 % en 2016) [8]. Cependant, ces enquêtes se réfèrent à l'ensemble de la province de Québec et peuvent agréger Montréal avec les villes voisines ; des enquêtes municipales à plus petite échelle suggèrent que la part des transports en commun à Montréal même approche les 20-25 %. Néanmoins, les voitures représentent toujours la majeure partie des déplacements domicile-travail.
Distances et temps de déplacement
Statistique Canada ne publie pas de ventilations distance/temps pour 2021 au niveau de la RMR, mais les données passées montrent que le navetteur montréalais moyen passe environ 25 à 30 minutes par trajet (comparable à Toronto). Les différences modales sont importantes : les usagers des transports en commun parcourent souvent de plus longues distances mais ont accès à des voies réservées, tandis que les conducteurs ont tendance à avoir des itinéraires plus courts mais subissent une congestion occasionnelle. Les trajets à vélo à Montréal sont généralement de 5 à 6 km par trajet pour les cyclistes quotidiens, bien que de nombreuses marches plus courtes (surtout au centre-ville) remplacent complètement les courts trajets en voiture. Des études évaluées par des pairs indiquent que l'« étalement urbain » dans les arrondissements périphériques entraîne de longs trajets en voiture, tandis que la densification dans les centres-villes favorise des trajets à vélo plus courts. (Comme l'a noté un expert en transport montréalais, de nombreux trajets en transport en commun couvrent de plus longues distances radiales, tandis que les vélos absorbent les courts trajets intra-urbains [12].)
Tendances et objectifs
Montréal a connu un récent « boom du vélo ». Une analyse note que Montréal « est déjà en tête au Canada pour le nombre de cyclistes-travailleurs » – environ 20 % des Canadiens qui se rendent au travail à vélo vivent dans la région de Montréal [23]. Une enquête sur les déplacements de 2018-2024 a indiqué que les déplacements en modes actifs (marche + vélo) ont augmenté d'environ 28 % dans le Grand Montréal depuis 2018 [24]. Les objectifs du gouvernement municipal sont ambitieux : augmenter la part modale du vélo à 15 % d'ici 2027 [25] et atteindre 50 % de tous les déplacements en transport en commun ou en modes actifs dans le Grand Montréal d'ici 2050 [9]. La réalisation de ces objectifs nécessitera des investissements majeurs (l'expansion des pistes cyclables et du service BIXI – ce que la ville a fait, en budgétisant plus de 30 millions de dollars en 2024 [26] – ainsi que des extensions de transport en commun comme le REM et le prolongement du Métro) et des changements culturels pour s'éloigner de l'automobile.
Analyse des coûts des modes de déplacement
Cette section quantifie les coûts monétaires supportés par les navetteurs pour chaque mode. Nous distinguons les coûts directs (tarifs, carburant, entretien, etc.) et les dépenses indirectes (amortissement de l'achat du véhicule, assurance, stationnement, etc.). Tous les chiffres sont en dollars canadiens de 2025, sauf indication contraire.
Coûts du Métro (STM)
-
Tarifs : Le tarif adulte standard pour les transports en commun de Montréal (Métro + bus STM + train de banlieue intra-urbain) est actuellement de 3,50 $ par billet simple ou de 100 $ pour un laissez-passer mensuel illimité pour la Zone A (l'île de Montréal) (Source: www.artm.quebec). Un laissez-passer mensuel est valide sur tous les Métros et bus de la STM, ainsi que sur le REM et le train Exo à l'intérieur de la Zone A. Ce forfait de 100 $/mois (soit 1 200 $/an s'il est utilisé chaque mois) offre des trajets illimités. Converti en coût quotidien (en supposant environ 22 jours ouvrables/mois), un laissez-passer mensuel coûte environ 4,55 $ par jour (pour un aller-retour).
-
Dépôt/Frais de carte : Le système de carte OPUS a un coût unique (achat de la carte à 6 $), mais cela est négligeable sur le long terme. Il n'y a pas de frais de déverrouillage comme pour les vélos en libre-service.
-
Coûts additionnels : Si un navetteur utilise rarement les transports en commun, les tarifs à l'unité (3,50 $) ou les laissez-passer hebdomadaires/24 heures pourraient être moins chers ; mais les navetteurs réguliers optent presque toujours pour le laissez-passer mensuel. Pour une utilisation occasionnelle des transports en commun (par exemple, quelques fois par semaine), les coûts par trajet (3,50 $) sont toujours inférieurs à ceux des courts trajets en voiture (voir la section Voiture ci-dessous).
-
Subventions de l'employeur : De nombreuses entreprises montréalaises offrent des allocations de transport ou des avantages avant impôt, conformément aux incitations provinciales pour l'écomobilité. (Environ 10 % des travailleurs interrogés reçoivent un certain remboursement pour le transport en commun.) De tels programmes peuvent effectivement réduire le coût net des déplacements en Métro, mais ils dépassent le cadre de ce rapport.
Coûts des déplacements en voiture
La possession et l'utilisation d'une automobile privée impliquent plusieurs composantes de coût :
-
Achat/Dépréciation : L'achat initial d'une voiture (neuve ou d'occasion) représente un coût initial majeur. Au Canada, le prix moyen d'une voiture neuve est d'environ 50 000 $ (2024) et même les véhicules d'occasion coûtent 20 000 à 30 000 $ ou plus en raison de la forte demande. La dépréciation (perte de valeur au fil du temps) est d'environ 3 000 à 5 000 $ par an pour une berline typique. (Pour simplifier, nous amortissons l'achat dans le coût annuel de possession ci-dessous.)
-
Carburant : Le carburant est une dépense courante substantielle. En 2025, les prix du carburant brut au Québec sont d'environ 1,30 $ à 1,50 $ le litre (après la suppression de la taxe carbone [27]). Une voiture de taille moyenne pourrait consommer environ 8 L/100 km (conduite mixte), donc le coût du carburant est d'environ 0,10 $ à 0,12 $ par km. Si un navetteur parcourt 50 km par jour (25 km aller simple) × 220 jours ouvrables/an = 11 000 km, le carburant seul représente environ 1 320 $/an (à 1,50 $/L) ou moins si le véhicule est plus économe en carburant.
-
Entretien et réparations : L'entretien courant (vidanges d'huile, pneus, freins, réparations mineures) coûte généralement 800 $ à 1 200 $ par an pour une berline canadienne. Plus si des réparations sont nécessaires. Le remplacement des pneus peut dépasser 800 $ tous les quelques ans.
-
Assurance : Au Québec, l'assurance automobile est obligatoire via la DPA gouvernementale (règlement). Pour un conducteur typique, les primes d'assurance s'élèvent souvent en moyenne à 1 000 $ à 1 500 $ par an, selon le dossier de conduite et le véhicule. Les jeunes conducteurs ou les nouveaux conducteurs paient souvent beaucoup plus.
-
Immatriculation et taxes : Les frais d'immatriculation et de permis de conduire coûtent quelques centaines de dollars par an (150 $ à 250 $). Il y a aussi des taxes de vente provinciales sur le carburant (incluses dans le prix à la pompe) et une taxe carbone actuellement gelée (à partir de 2025).
-
Stationnement/Péages : De nombreux navetteurs urbains paient pour le stationnement. Le stationnement mensuel au centre-ville peut coûter 150 $ à 300 $ ou plus. Nous estimons prudemment 1 000 $/an pour le stationnement des citadins en moyenne. (Les navetteurs des banlieues peuvent payer moins mais encourent tout de même des frais de stationnement ou des péages.)
-
Autopartage/Location : Il est à noter que certains navetteurs utilisent des services d'autopartage (comme Communauto) au lieu de posséder une voiture ; ceux-ci ont leurs propres structures tarifaires (par exemple, 60 $/an d'adhésion + 0,20 $/min et plus). Ces alternatives coûtent généralement plus cher par utilisation que la possession si l'on se déplace quotidiennement, mais peuvent convenir aux conducteurs occasionnels. Ce rapport se concentre sur la possession et l'utilisation d'un véhicule personnel.
Coût total : La combinaison des éléments ci-dessus donne un coût annuel typique de la voiture de l'ordre de 5 000 $ à 7 000 $. Une récente enquête auprès des consommateurs a révélé que le Canadien moyen dépense 5 497 $ par an pour la possession et l'utilisation d'un véhicule [1]. (Les conducteurs de l'Ontario étaient les plus élevés à environ 6 000 $ ; les conducteurs du Québec probablement un peu moins.) Cela correspond à notre somme de carburant + assurance + entretien + amortissement + frais. En pourcentage, les dépenses automobiles peuvent consommer environ 14 % du budget d'un ménage [14].
En tant que chiffre par kilomètre, divers calculateurs (CAA, Réseau) estiment souvent un coût total d'environ 0,50 $ à 0,60 $ par km pour la possession d'une voiture (y compris l'amortissement) au Canada. Le carburant seul ne représente qu'environ 0,12 $/km, mais l'assurance/l'entretien et la dépréciation doublent à peu près ce montant. Ainsi, un trajet de 20 km « coûterait » environ 10 $ par jour (carburant ~2,40 $ + autres 7,60 $).
Coûts des déplacements à vélo
Le vélo est de loin le mode le moins coûteux :
-
Achat : Un vélo de navette décent au Canada coûte entre 300 $ (très basique) et plus de 2 000 $ (haut de gamme ou vélo électrique). Supposons qu'un vélo de qualité typique coûte 800 $. Si la durée de vie utile du vélo est de 8 ans de déplacements réguliers, le coût de dépréciation est de 100 $/an.
-
Accessoires/Entretien : L'équipement obligatoire (casque, lumières, antivol) pourrait coûter 100 $ à 200 $ initialement. De manière continue, les cyclistes prévoient un budget pour les mises au point, les nouveaux pneus, les chaînes – peut-être 100 $ à 150 $ par an. Avec un entretien approprié, les révisions des composants peuvent être espacées.
-
Vélopartage (BIXI) : Alternativement, de nombreux navetteurs utilisent le service public de vélopartage. L'abonnement mensuel de BIXI est de 23 $ (tous les mois d'hiver) [2], avec une option saisonnière d'environ 90 $ (avril-novembre) pour des trajets courts illimités. À 23 $/mois toute l'année, le coût annuel est de 276 $. (À comparer à 1 200 $ pour les transports en commun ou 5 500 $ pour une voiture.) Il n'y a pas de frais par trajet pour les déplacements de moins de 45 minutes ; au-delà, des frais de 0,18 $/min s'appliquent. Pour les trajets typiques, le dépôt de déverrouillage est de 0 $.
-
Autres coûts : Les cyclistes ne paient pas de frais de route ou de stationnement. Les vélos peuvent être volés (certains cyclistes assurent les vélos coûteux), mais autrement, la dépense financière est triviale. Un vélo électrique (assistance électrique) coûte plus cher (1 500 $ à 3 000 $) mais élimine les coûts de carburant supplémentaires – cependant, la recharge d'un vélo électrique consomme une électricité négligeable (une recharge complète ~0,10 $) étant donné l'électricité bon marché du Québec.
En résumé, les coûts annuels du cyclisme sont très faibles – de l'ordre de 150 $ à 300 $ (en supposant un entretien modéré et soit l'amortissement du vélo, soit un abonnement BIXI). Un déplacement à vélo représente de loin la dépense la plus faible par kilomètre. Le tableau 1 ci-dessous compare les coûts annuels représentatifs pour chaque mode.
| Mode | Principales composantes de coût (annuel) | Coût annuel approx. (CAD) |
|---|---|---|
| Métro (Laissez-passer illimité) | ~12×100 $ laissez-passer mensuel STM (Source: www.artm.quebec); extras minimes | ≈1 200 $ (métro/bus illimité) (Source: www.artm.quebec) |
| Voiture (essence) | Carburant (environ 1,30 $/L, environ 8 L/100km), assurance, entretien, amortissement [1], stationnement | ≈5 500 $ (Alt. 5 à 6 k$/an tout compris) [1] |
| Vélo (personnel) | Vélo amorti (800 $/8 ans ≈100 $), entretien 150 $, équipement | ≈250 $ (vélo + entretien) |
| Vélopartage BIXI | Adhésion 23 $/mois [2] (s'applique aux trajets illimités de 45 min) | ≈276 $ (12×23 $) [2] |
Tableau 1 : Coûts annuels des déplacements par mode (Montréal, 2025). Sources : Grille tarifaire STM/ARTM (Source: www.artm.quebec), enquêtes de marché [1], tarifs BIXI [2], et estimations de coûts. (Les coûts des voitures personnelles varient considérablement ; le chiffre de 5 500 $ représente un cas typique de milieu de gamme [1].)
D'après le tableau 1, nous constatons que les déplacements en voiture sont environ 4 à 5 fois plus chers par an que l'utilisation complète du métro, et un ordre de grandeur plus coûteux que le vélo. Même en tenant compte de l'achat unique d'un vélo, le cyclisme représente un coût essentiellement négligeable par rapport aux autres modes. Le fardeau financier des voitures souligne pourquoi les gouvernements municipaux facturent souvent des frais de stationnement élevés et investissent dans des subventions aux transports en commun : ils visent à internaliser une partie de ces coûts supportés par les navetteurs et la société (congestion, qualité de l'air).
Analyse de l'empreinte carbone
Cette section examine les émissions de gaz à effet de serre associées à chaque mode de déplacement. Nous utilisons des facteurs d'émission moyens et des estimations de cycle de vie pour comparer la production d'équivalent CO₂ par passager-kilomètre et par trajet typique. Tous les chiffres sont en équivalent CO₂ (CO₂e).
Métro (Rail électrique)
Le Métro de Montréal est entièrement électrique, puisant une énergie peu émettrice. Il est crucial de noter que le réseau électrique du Québec est à plus de 95 % hydroélectrique (le reste fossile/nucléaire est marginal). Ainsi, les émissions directes de carbone liées à l'exploitation du Métro sont extrêmement faibles. Une analyse de l'industrie du transport en commun révèle :
-
Émissions du Métro ~15 g CO₂e par passager-km. Dans un calcul orienté utilisateur, un aller-retour de 20 km en Métro a été estimé à seulement 0,3 kg de CO₂, soit 0,015 kg/km [3]. Cela correspond à 15 g/km, environ. (Ce chiffre inclut les émissions en amont pour l'hydroélectricité québécoise ; en réalité, l'apport fossile est négligeable, donc en moyenne <0,02 kg/km.)
-
Énergie stationnaire : La ventilation, l'éclairage, les escaliers mécaniques consomment de l'électricité, mais ils fonctionnent également principalement à l'hydroélectricité. Même si l'on attribuait une part de l'énergie des sous-stations, cela n'ajouterait que quelques grammes par km.
-
Cycle de vie : La construction des tunnels et des trains a un coût carbone intrinsèque, mais amorti sur des décennies et des millions d'usagers, cela est négligeable par trajet (environ quelques grammes au maximum). Nous nous concentrons sur les émissions opérationnelles.
En revanche, une voiture à moteur thermique moyenne émet de l'ordre de 120 à 180 g de CO₂e par km (CO₂ à l'échappement seulement). Par exemple, une voiture à essence de taille moyenne pourrait consommer environ 8 L/100km ; comme l'essence émet environ 2,3 kg de CO₂/L, cela représente environ 0,18 kg/km (180 g/km). Une voiture plus petite (ou hybride) pourrait être d'environ 6 L/100km (140 g/km). L'exemple utilisateur ci-dessus supposait 0,120 kg/km [3] (120 g/km), ce qui est une estimation basse pour une voiture – reflétant un véhicule assez efficace. Ainsi, même au minimum (120 g/km), une voiture est environ 8 fois « pire » [en CO₂] par km que les 15 g/km du Métro.
L'implication pratique est frappante : un passager-km en Métro est essentiellement sans carbone. Un trajet typique de 10 km en Métro ne produit qu'environ 0,15 kg de CO₂. Le même trajet en voiture génère environ 1,2 à 1,8 kg de CO₂ (selon le véhicule) – soit environ dix fois plus. En effet, le calcul précédent de FabMob a trouvé un trajet de 20 km en voiture à 2,4 kg contre 0,3 kg en Métro [28]. Sur une année, la différence s'accumule : 100 trajets de 20 km chacun permettent d'économiser environ 210 kg de CO₂ en utilisant le Métro [5].
De plus, parce que le réseau de Montréal est si propre, même les bus diesel (si l'on les considère) sont beaucoup plus polluants : les bus STM fonctionnant au diesel (bien qu'ils passent progressivement aux hybrides) émettent généralement environ 80 à 100 g de CO₂e/passager-km (en supposant une occupation modérée), comparé à environ 15 g pour le Métro. (Dans le mix énergétique des transports en commun de Montréal, le diesel domine toujours les bus [29] et représente donc la majeure partie des émissions de GES des transports en commun.) En résumé, les déplacements en transport en commun à Montréal ont une empreinte carbone négligeable par rapport aux voitures [3] [30].
Émissions des voitures privées
Les voitures émettent du carbone principalement en brûlant de l'essence (ou du diesel). Nous considérons une berline typique à essence :
-
Émissions de carburant : Comme indiqué, l'essence produit environ 2,3 kg de CO₂ par litre brûlé. À 8 L/100 km, cela représente environ 0,184 kg/km (184 g/km). En ville, dans la circulation en accordéon, les émissions peuvent être plus élevées en raison du ralenti et des accélérations. Une voiture de navette modeste pourrait émettre en moyenne 0,12 à 0,18 kg de CO₂/km sur un trajet mixte.
-
Occupation : À titre de comparaison, si une voiture transporte en moyenne 1,1 personne (données du recensement : 4,6 % de covoiturage [6]), un km de voiture compte toujours pour environ 120 à 180 par passager-km si elle est presque vide. Si le covoiturage se fait avec 2 passagers, l'empreinte par personne est divisée par deux (environ 60 à 90 g/km), mais cela dépasse toujours les transports en commun. Il est à noter qu'un encouragement actif au covoiturage pourrait améliorer cette métrique, mais actuellement, la plupart des conducteurs montréalais voyagent seuls.
-
Considérations sur le cycle de vie : En plus du carburant, la fabrication et l'élimination des voitures ajoutent des émissions. Les émissions de cycle de vie des voitures sont environ 20 % plus élevées que les valeurs des émissions à l'échappement seulement (selon la taille de la voiture). Mais même en incluant cela, une voiture typique émet toujours de l'ordre de 150 à 200 g de CO₂e par personne-km.
-
Véhicules électriques (VE) : Pour être complet, les voitures rechargeables modifient considérablement l'empreinte au Québec. Un VE au Québec a des émissions de CO₂ à l'échappement pratiquement nulles (puisque son électricité est hydroélectrique). Cependant, les émissions intrinsèques de la fabrication (en particulier de la batterie) s'élèvent toujours à environ 50 à 100 g de CO₂e/km amortis. Ainsi, un VE québécois pourrait avoir des émissions de CO₂ 80 à 90 % inférieures par km à celles d'une voiture à essence. Les VE sont en croissance (Montréal comptait environ 7 % de nouvelles voitures électriques en 2025), mais à la mi-2025, ils représentent encore une petite partie du parc automobile. Pour cette analyse, nous considérons la « Voiture » comme étant à essence/diesel.
Émissions du vélo
L'utilisation d'un vélo n'entraîne pratiquement aucune émission directe de CO₂. Le seul carburant est les calories humaines, qui pour un navetteur font généralement partie de l'apport alimentaire. Si l'on voulait être très strict, on pourrait attribuer certaines émissions de production alimentaire au cyclisme, mais les études ignorent généralement cela ou notent que c'est moins que la marche. En termes de cycle de vie :
-
Fabrication : Le coût carbone de la fabrication d'un vélo est faible (< 200 kg de CO₂ pour un vélo en alliage haut de gamme [4]). Si le vélo est utilisé sur 5 000 à 10 000 km par an pendant de nombreuses années, la part par km tombe à quelques dizaines de grammes. Un chiffre couramment cité est d'environ 16 à 50 g de CO₂e par km pour le cyclisme, selon l'efficacité (métabolisme humain et régime alimentaire) [4]. Cela inclut l'apport alimentaire (par exemple, si vous brûlez 200 kcal/km et supposez 5 kg de CO₂ pour 1 000 kcal de nourriture, cela représente 1 kg de CO₂ pour 5 km = 200 g/km – mais en pratique les régimes varient, et 50 g/km pour un cycliste très en forme est optimiste).
-
Vélos électriques : Si l'on utilise un vélo à assistance électrique, la faible consommation électrique (environ 0,02 kWh/km) n'émet pratiquement aucun CO₂ au Québec. (Même en chargeant à partir de la batterie d'un VE, le CO₂ du réseau est négligeable grâce à l'hydroélectricité.) Le poids supplémentaire et la fabrication de la batterie ajoutent un peu à l'empreinte du cycle de vie, mais restent bien en dessous des voitures.
En pratique, le cyclisme est effectivement neutre en carbone pour les déplacements. Que ce soit sur un vélo mécanique ou électrique, les cyclistes évitent les vastes émissions que les voitures produisent. La seule mise en garde est que si le cyclisme permet une alimentation supplémentaire au-delà de la normale (rare pour les courts trajets), ce CO₂ métabolique augmenterait. Mais à toutes fins utiles, remplacer les trajets en voiture par le vélo élimine presque tout le CO₂ des transports.
Le tableau 2 résume les intensités d'émission.
| Mode | Émissions typiques de CO₂ (g CO₂e / passager-km) | Commentaires |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Vélo (humain) | 16–50 [4] | Moy. cycle de vie : émissions opérationnelles quasi nulles ; liées à l'alimentation | | Métro de Montréal | ≈15 [3] | Trains électriques sur un réseau ~99 % hydroélectrique (≈1 ktCO₂/an provenant de l'énergie) [30] | | Autobus (STM diesel)| ~80–100 (varie) | Par passager ; estimation très approximative (carburant diesel, taux d'occupation ~30 %) | | Voiture (compacte, essence)| ~120–180 [3] | À 6–9 L/100 km ; par passager si conducteur seul ~même valeur | | Voiture (VUS, essence)| ~180–250 | Véhicule plus grand ~consommation de carburant plus élevée ; peut dépasser 250 g/km par p-km |
Tableau 2 : Émissions typiques équivalent CO₂ par mode. Sources comme indiqué ci-dessus. Le chiffre du Métro [3] suppose l'électricité propre du Québec ; les valeurs des voitures supposent le carburant essence.
D'après le Tableau 2, nous constatons que les déplacements en métro émettent un ordre de grandeur moins de GES par km qu'une voiture à essence, et les vélos encore moins (bien que leur faible distance absolue signifie souvent une compensation en pourcentage plus faible des émissions totales de déplacement). Ces facteurs seront utilisés pour comparer les scénarios de modes ci-dessous.
Analyse Comparative et Études de Cas
Nous rassemblons maintenant les données sur les coûts et le carbone pour comparer les modes de transport en tête-à-tête et illustrer avec des exemples concrets.
Coût par Scénario de Déplacement Domicile-Travail
Considérons un navetteur hypothétique qui parcourt 15 km par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre au travail cinq jours par semaine (≈220 jours ouvrables/an). (Cela représente un déplacement de banlieue ; un résident du centre-ville pourrait plutôt faire du vélo ou prendre un court trajet en Métro au lieu d'une voiture.)
-
En Métro : À 100 $/mois, le coût quotidien est d'environ 4,55 $ pour un transport illimité. Pour 220 jours, cela représente ≈1 001 $/an. (Même en dehors de cela, on pourrait acheter des billets de 10 passages ou des abonnements hebdomadaires, mais l'abonnement mensuel est le moins cher pour les usagers fréquents.) Les segments de trajet supplémentaires vers/depuis la station (autobus ou marche) sont couverts par l'abonnement. Le stationnement n'est généralement pas nécessaire.
-
En Voiture : Le navetteur parcourt 30 km par jour, soit environ 6 600 km/an. Le carburant à, disons, 8 L/100km et 1,30 $/L coûte 686 $/an. Ajoutez l'assurance (~1 200 $), l'entretien (~1 000 $), la dépréciation (2 500 $), l'immatriculation (150 $) et le stationnement (1 200 $) – un total de 6 736 $/an. Par trajet (30 km), cela représente environ 30 $ par aller (60 $/jour) si agrégé linéairement. (Même en omettant les coûts fixes, le carburant + le stationnement seuls représentent ~1 886 $/an ≈8,57 $/jour).
-
À Vélo (personnel) : Supposons un vélo de 800 $, une durée de vie de 10 ans (80 % d'utilisation en ville), entretien de 150 $/an. Total ~230 $/an, soit ~1 $ par jour ouvrable. Pas de frais de carburant ou de stationnement. (Même si le cycliste ne fait du vélo que 150 jours/an, le coût par jour est d'environ 1,50 $.)
-
En Vélopartage BIXI : 23 $/mois revient à 276 $/an. Pour 220 jours, 1,25 $ par jour, plus 0,18 $/minute si un trajet dépasse 45 min (la plupart des déplacements domicile-travail durent ~15–25 min, donc les frais supplémentaires sont rares).
Une comparaison instantanée par jour ouvrable pour ce trajet de 15+15 km : Métro ≈4,55 $ (abonnement) + bus/marche modeste du dernier kilomètre ; Voiture ≈30 $ (tous frais inclus) ; Vélo ≈1–2 $ ; BIXI ≈1,25 $. Sur un an, Métro ~1 000 $ contre Voiture ~6 700 $ contre Vélo <300 $. (Ces exemples sont approximatifs ; évidemment, les coûts individuels varient, mais les pourcentages restent valables.)
Carbone par Scénario de Déplacement Domicile-Travail
Pour le même déplacement quotidien de 30 km :
-
Métro : ~0,015 kgCO₂/km × 30 km = 0,45 kg CO₂ par jour. Annuellement (220 jours), cela représente ≈99 kg CO₂. Ceci suppose une pleine occupation ; en période creuse à faible achalandage, l'impact par passager pourrait être légèrement plus élevé, mais resterait négligeable.
-
Voiture : 0,12–0,18 kg/km (voir Tableau 2). À 0,12, 30 km donnent 3,6 kg CO₂/jour, soit ~792 kg CO₂/an (220 jours). À 0,18, ce serait 5,4 kg/jour (1188 kg/an). Même en milieu de gamme (~0,15 kg/km), c'est 4,5 kg/jour, soit ~990 kg/an.
-
Vélo (personnel/BIXI) : Même en utilisant 50 g (0,05 kg) par km sur le cycle de vie, 30 km représentent 1,5 kg CO₂/jour, soit 330 kg/an. Mais notez : la plupart des émissions des vélos proviennent de la fabrication/alimentation, pas du pot d'échappement ; opérationnellement, c'est essentiellement nul.
Ainsi, utiliser un Métro électrique au lieu d'une voiture pour ce navetteur évite environ 700–900 kg de CO₂ par an – bien plus de 0,7 tonne. C'est comme retirer 1 à 1,3 voiture moyenne de la circulation pour l'année. En revanche, si cette personne faisait le trajet à vélo (au lieu de conduire), elle réduirait d'environ 450–800 kg de CO₂ son empreinte personnelle (encore une fois ~0,5–0,8 t). Le Tableau 3 ci-dessous compare directement ces scénarios de déplacement :
| Mode de déplacement | Aller-retour quotidien (km) | Coût par jour ouvrable | Coût annuel ($) | CO₂ par jour (kg) | CO₂ annuel (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Métro | 30 | ≈4,55 $ (abonnement/jour) (Source: www.artm.quebec) | 1 001 $ | 0,45 (≈0,015×30) [3] | 99 |
| Voiture | 30 | ≈30 $ (tout compris) [1] | 6 736 $ | ≈3,6 (0,12×30) [3] | 792 |
| Vélo (personnel) | 30 | ≈1–2 $ (dépréciation+entretien) | 230 $ | ≈1,5 (0,05×30) [4] | 330 |
| Vélo BIXI | 30 | 1,25 $ (abonnement) [2] | 276 $ | ≈1,5 (même hypothèse) | 330 |
Tableau 3 : Exemple des coûts annuels de déplacement et des émissions de CO₂ pour un trajet quotidien de 30 km. (Coût Métro = abonnement mensuel de 100 $ ; Coût Voiture = carburant+assurance+etc [1] ; Coût Vélo = amortissement+entretien ; Taux de CO₂ du Tableau 2.)
Le Tableau 3 illustre les avantages écrasants des modes verts. Le déplacement en voiture accumule plus de 6 tonnes de CO₂ par an pour l'ensemble des navetteurs dans ce scénario, contre seulement 0,1 à 0,3 tonne pour les transports en commun ou le vélo. De même, la voiture coûte plusieurs milliers de dollars par an, comparativement à moins de 1 000 $ pour le Métro et seulement quelques centaines pour le vélo. Même si l'on valorise son temps (par exemple, le Métro pourrait être légèrement plus lent), les pénalités économiques et climatiques de la conduite sont des ordres de grandeur plus importants.
Étude de Cas : Le Navetteur de Banlieue
Pour ancrer l'analyse, considérons un exemple concret : un travailleur résidant à Laval (une banlieue de Montréal) se déplaçant au centre-ville. Il a trois options principales : traverser le pont Viau ou Papineau en voiture ; prendre un autobus de banlieue Laval–Montréal ; ou combiner bus + Métro. (Parcourir une telle distance à vélo serait exceptionnel.)
-
En Voiture : Trajet ~17 km aller simple. À 8 L/100km et 1,50 $/L, le carburant coûte ≈2,04 $ aller simple. Coût du carburant aller-retour ~4,10 $/jour. Ajouter les péages ? (Les ponts de Montréal n'ont actuellement pas de péages.) Le temps en période de pointe peut être de ~20–30 min par trajet. Carburant annuel ~910 $ ; assurance/entretien/dépréciation comme ci-dessus (~5 500 $ de coût total). CO₂ à 0,15 kg/km → ~2,6 kg/jour, 572 kg/an (transportant une personne) [3].
-
En Transport en Commun (Bus+Métro) : L'autobus 901 de la STL de Laval mène à la station de Métro Henri-Bourassa, puis le Métro jusqu'au centre-ville. Temps total ~45–60 min combiné. Tarif : couvert par un abonnement mensuel de 100 $ (Source: www.artm.quebec). Stationnement à domicile illimité dans la rue. CO₂ : supposons une portion de 5 km en bus + une portion de 12 km en métro. Le bus émet ~0,08 kg/km (avec de nombreux passagers) => 0,4 kg. Le Métro émet 0,015/kg*12 = 0,18 kg. Total ~0,58 kg par jour, 127 kg/an.
-
Covoiturage/Vélos Électriques Hybrides : Le covoiturage à 2 personnes (partage des coûts fixes) réduit de moitié l'empreinte par personne ~286 kg/an. L'autonomie locale des voitures électriques est limitée ; mais si le navetteur de Laval avait un VE, les 572 kg pourraient chuter à ~100 kg (cycle de vie) — compétitif avec les émissions des transports en commun.
Ce cas reflète le schéma général. Les transports en commun sont plus lents mais ~5 fois moins émetteurs de CO₂ et beaucoup moins chers que la conduite en solo (tant qu'un bus ou un train peut être pris). Cela évite également les coûts de stationnement au centre-ville. L'objectif de planification de Montréal d'étendre les liaisons de transport en commun express (comme la branche REM Rive-Sud ou le prolongement du Métro) vise à rendre ces déplacements plus rapides et plus attrayants.
Perspective : Coûts pour le Voyageur vs. Coûts Environnementaux
Il est intéressant de noter que les sondages indiquent que de nombreux Montréalais perçoivent les transports en commun comme plus chers ou plus polluants qu'ils ne le sont en réalité. L'étude MDPI a révélé que les répondants surestimaient les coûts de carburant et environnementaux des déplacements [13], évaluant souvent le Métro comme plus émetteur que les voitures. En réalité, comme montré ci-dessus, les coûts carbone/économiques du Métro sont bien inférieurs. Une autre étude note que les conducteurs montréalais parcourent typiquement 10 000 à 15 000 km/an ; à 150 g/km, cela représente 1,5 à 2,25 tonnes de CO₂ annuellement par conducteur – similaires ou supérieurs aux émissions typiques des vols [31] [13]. Pourtant, la sensibilisation du public est faible. Il a été démontré que fournir des informations en temps réel sur le carburant et les émissions (via des applications) peut inciter certains conducteurs à choisir des itinéraires plus écologiques [13].
En termes de coûts, un tarif de transport en commun de 100 $/mois permet environ 160 trajets (en supposant un mois de 20 jours, 4 trajets/jour). Chaque trajet en Métro économisant ~2,4 – 3,5 kg de CO₂ (par rapport à un trajet en voiture similaire) [3], un abonnement mensuel pourrait économiser ~500 kg de CO₂ en un mois de déplacement domicile-travail seulement. Même si quelqu'un pense que « le Métro cause des émissions d'électricité », au Québec, c'est une préoccupation négligeable : son intensité marginale de CO₂ est proche de zéro. En bref, la narrative étayée par des preuves est que chaque passage d'un navetteur automobile au Métro génère une énorme réduction des émissions à faible coût.
Infrastructures, Tendances et Implications Politiques
Objectifs Gouvernementaux
Les gouvernements municipaux et régionaux reconnaissent les enjeux. Les documents officiels de Montréal soulignent que pour atteindre la carboneutralité, les habitudes de transport doivent changer [32]. Les routes représentent désormais environ 43 % des émissions de la ville, de sorte que le plan climat municipal (2015, mis à jour en 2022) priorise la mobilité durable. Parmi ses actions clés figurent :
-
Développer les Réseaux de Transport en Commun et Actifs : « Développer davantage les transports en commun et les transports actifs » [11] ; à l'échelle de la zone, l'ARTM vise 50 % des déplacements en modes public/actif d'ici 2050 [9]. Les investissements récents incluent l'ajout de **33 km de pistes cyclables en 2024 [26] et des prolongements de la Ligne Bleue du Métro.
-
Électrification : Le plan exige 100 % d'autobus zéro émission d'ici 2040 [11] et encourage la recharge/l'infrastructure des VE. Déjà, la flotte de la STM comprend des centaines d'autobus électriques, et les ventes d'automobiles au Québec tendent vers >20 % électriques.
-
Aménagement du Territoire : Les politiques encouragent le développement de la ville du quart d'heure – des quartiers à usage mixte qui réduisent les distances de déplacement. La conversion de grands stationnements en logements ou en parcs est une autre stratégie [33]. En réduisant la distance de déplacement et en permettant la marche/le vélo, ces mesures réduisent à la fois le coût et les émissions par trajet.
-
Mesures Réglementaires : La Ville offre également des incitatifs (crédits d'impôt pour véhicules verts, allégements fiscaux pour les employeurs en matière de transport en commun) et des désincitatifs (resserrement des limites de stationnement, règlements sur la marche au ralenti). Une « Étude d'impact » à venir évalue une éventuelle taxe carbone sur l'essence routière ou une tarification de la congestion.
Les professionnels avertissent que Montréal doit surmonter l'inertie « culturelle et structurelle » [12]. De nombreuses parties de la zone urbaine restent axées sur la voiture (faible densité, autoroutes). Encourager le transfert modal nécessitera des politiques et des changements de comportement soutenus. Cela dit, l'efficacité du système de transport en commun et la culture du vélo de Montréal sont parmi les plus solides du Canada. La commodité et le faible coût du Métro, combinés aux rues cyclables de la ville, signifient que de nombreux trajets peuvent déjà être effectués sans voiture (dans les zones à forte densité). L'implication politique est d'accélérer les infrastructures là où il y a des lacunes, telles que des corridors de bus améliorés alimentant le Métro, des pistes cyclables plus sécurisées dans les arrondissements extérieurs, et l'intégration du vélo avec les transports en commun (stationnement pour vélos aux stations).
Orientations Futures
-
Adoption des Véhicules Électriques : Montréal doit tenir compte de l'essor des VE. L'électrification réduira les émissions des voitures, réduisant l'écart avec les transports en commun. Cependant, les VE ne font rien pour soulager la congestion ou la demande de stationnement, et les émissions de leur cycle de vie (production de batteries, pertes d'électricité) ne sont pas nulles. Néanmoins, comme le réseau est propre, encourager les conducteurs à utiliser des véhicules hybrides rechargeables (avec une occupation plus élevée, même comme navettes à courte portée) peut compléter d'autres stratégies.
-
Télétravail : La flambée du télétravail à l'ère de la COVID (plus de 25 % au sommet) a partiellement reculé (17,4 % encore en télétravail d'ici mi-2025) [34], mais le travail hybride reste une voie pour réduire entièrement les déplacements. Un jour de moins de conduite par semaine réduit d'environ 30 % les émissions et les coûts de déplacement. La politique municipale pourrait promouvoir un zonage favorable au télétravail ou des incitatifs pour les jours de déplacement durable.
-
Tarification et Information : Comme montré dans [4], fournir aux navetteurs des informations transparentes sur les coûts et le carbone peut influencer les choix. Les applications et les écrans embarqués qui affichent des comptes à rebours en dollars et en grammes peuvent sensibiliser. La tarification dynamique – par exemple, les péages de congestion sur les grands ponts – pourrait davantage modifier les comportements, comme démontré dans d'autres villes.
-
Exemple de Cas – Prime Montréal–Longueuil : Une étude récente de Stewart a noté qu'une barrière existe pour les navetteurs à mobilité réduite (fauteuil roulant, poussette) utilisant les transports en commun : pour certains trajets Montréal-Longueuil, les transports en commun peuvent être plus lents que la voiture de 5 à 80 minutes en raison des correspondances et des retards d'ascenseur [9]. Résoudre ces problèmes d'équité/d'accès sera vital. Par exemple, rendre tous les bus/rames à plancher bas et synchroniser les horaires peut améliorer la compétitivité des transports en commun.
-
Modes Émergents : La micromobilité (trottinettes électriques, vélos électriques) est en croissance. Montréal a commencé à légaliser la location de trottinettes et à étendre les bornes de recharge pour vélos électriques. Des études préliminaires sur le cycle de vie suggèrent que les vélos électriques ont des émissions par km similaires ou légèrement supérieures à celles des vélos conventionnels (en raison de la production), mais toujours bien inférieures à celles des voitures. Les incitatifs publics à l'achat de vélos électriques (annoncés à l'échelle provinciale) stimuleront probablement la part du vélo.
-
Lacune en matière de Transport Actif : Malgré la croissance, le vélo pour se rendre au travail ne représentait qu'environ 3 à 4 % il y a quelques années [35]. Atteindre un objectif de 15 % de part modale pour le vélo est extrêmement difficile, mais les tendances récentes (par exemple, 13 millions de trajets BIXI en 2024 [21]) indiquent une forte demande latente. Un investissement continu dans les pistes cyclables quatre saisons et l'éclairage prismatique sera essentiel.
Résumé
Toutes les preuves convergent : Le vélo et le Métro sont de loin supérieurs à la voiture à Montréal, tant sur le plan économique qu'environnemental. Le coût financier par kilomètre des voitures (environ 0,50 à 0,60 $/km) éclipse les abonnements de transport en commun (environ 0,18 $/km s'il est pleinement utilisé) et le vélo (environ 0,01 $/km). Les émissions de carbone par kilomètre des voitures (120 à 180 g/km) dépassent largement celles du Métro (≈15 g/km [3]) ou du vélo (≈30 g/km [4]). Les mesures politiques (tarifs, taxes, subventions) reflètent de manière appropriée certaines de ces différences.
L'implication plus large est que chaque conversion d'un conducteur vers les transports en commun génère un bénéfice sociétal démesuré (réduction de la pollution, de l'usure des routes, des accidents). Pourtant, les parts modales actuelles montrent qu'il reste beaucoup à faire. Les stratégies de Montréal – expansion du Métro/REM, doublement des pistes cyclables, promotion des VE – sont des pas dans la bonne direction. En intégrant toutes ces conclusions, un avenir de déplacement durable pour Montréal doit fortement privilégier les modes actifs et collectifs, en alignant une planification détaillée avec les données concrètes sur les coûts et les émissions.
Conclusion
Les Montréalais paient un prix élevé – en dollars et en carbone – pour leurs déplacements en voiture. Notre étude comparative montre que les transports en commun et le vélo sont considérablement plus efficaces : un abonnement de métro de 100 $/mois offre des trajets illimités avec une empreinte carbone quasi nulle, tandis qu'une voiture coûte plus de 5 000 $/an et émet près d'une tonne de CO₂ par 11 000 km. Le vélo est encore moins cher et ses émissions sont quasi nulles. Ces contrastes sont étayés par les dernières données : la part modale des transports en commun augmente mais n'atteint encore qu'environ 20 %, celle du vélo est proche de 8 % [7] [8], tandis que les voitures dominent.
Pour l'avenir, les plans climatiques et de transport de Montréal dépendent d'un rééquilibrage. Si les politiques ciblées et les améliorations continues des infrastructures réussissent, nous devrions voir davantage de navetteurs échanger quatre roues contre deux ou contre des rails. Des études de cas confirment que pour un trajet typique en banlieue proche, prendre le métro électrique ou le vélo au lieu de conduire peut économiser environ 1 tonne de CO₂ par an par usager et des milliers de dollars de dépenses. Il ne s'agit pas seulement d'économies théoriques – elles impliquent des gains majeurs en matière de santé publique et de sécurité énergétique si elles sont multipliées à l'échelle de la ville.
En somme, ce rapport souligne que les modes de transport actifs et collectifs surpassent la voiture en termes de coût et de carbone. Les preuves basées sur les données présentées ici devraient éclairer les travailleurs, les employeurs et les décideurs politiques. Chaque Montréalais qui troque ses trajets en voiture contre des trajets en métro ou à vélo contribue à l'allègement fiscal de la ville et à ses objectifs climatiques. Le défi de Montréal est de rendre ce choix évident, grâce à des investissements continus et à l'éducation du public.
Sources : Toutes les données et affirmations présentées ici proviennent de sources officielles et universitaires. Les références clés incluent les enquêtes sur les déplacements de Statistique Canada [6] [7] [8], les documents de l'agence de transport et de planification urbaine de Montréal [10] [9] [30], et des études environnementales [3] [4]. Dans la mesure du possible, nous avons fourni des citations explicites pour les faits et les chiffres.
Sources externes
À propos de 2727 Coworking
2727 Coworking is a vibrant and thoughtfully designed workspace ideally situated along the picturesque Lachine Canal in Montreal's trendy Griffintown neighborhood. Just steps away from the renowned Atwater Market, members can enjoy scenic canal views and relaxing green-space walks during their breaks.
Accessibility is excellent, boasting an impressive 88 Walk Score, 83 Transit Score, and a perfect 96 Bike Score, making it a "Biker's Paradise". The location is further enhanced by being just 100 meters from the Charlevoix metro station, ensuring a quick, convenient, and weather-proof commute for members and their clients.
The workspace is designed with flexibility and productivity in mind, offering 24/7 secure access—perfect for global teams and night owls. Connectivity is top-tier, with gigabit fibre internet providing fast, low-latency connections ideal for developers, streamers, and virtual meetings. Members can choose from a versatile workspace menu tailored to various budgets, ranging from hot-desks at $300 to dedicated desks at $450 and private offices accommodating 1–10 people priced from $600 to $3,000+. Day passes are competitively priced at $40.
2727 Coworking goes beyond standard offerings by including access to a fully-equipped, 9-seat conference room at no additional charge. Privacy needs are met with dedicated phone booths, while ergonomically designed offices featuring floor-to-ceiling windows, natural wood accents, and abundant greenery foster wellness and productivity.
Amenities abound, including a fully-stocked kitchen with unlimited specialty coffee, tea, and filtered water. Cyclists, runners, and fitness enthusiasts benefit from on-site showers and bike racks, encouraging an eco-conscious commute and active lifestyle. The pet-friendly policy warmly welcomes furry companions, adding to the inclusive and vibrant community atmosphere.
Members enjoy additional perks like outdoor terraces and easy access to canal parks, ideal for mindfulness breaks or casual meetings. Dedicated lockers, mailbox services, comprehensive printing and scanning facilities, and a variety of office supplies and AV gear ensure convenience and efficiency. Safety and security are prioritized through barrier-free access, CCTV surveillance, alarm systems, regular disinfection protocols, and after-hours security.
The workspace boasts exceptional customer satisfaction, reflected in its stellar ratings—5.0/5 on Coworker, 4.9/5 on Google, and 4.7/5 on LiquidSpace—alongside glowing testimonials praising its calm environment, immaculate cleanliness, ergonomic furniture, and attentive staff. The bilingual environment further complements Montreal's cosmopolitan business landscape.
Networking is organically encouraged through an open-concept design, regular community events, and informal networking opportunities in shared spaces and a sun-drenched lounge area facing the canal. Additionally, the building hosts a retail café and provides convenient proximity to gourmet eats at Atwater Market and recreational activities such as kayaking along the stunning canal boardwalk.
Flexible month-to-month terms and transparent online booking streamline scalability for growing startups, with suites available for up to 12 desks to accommodate future expansion effortlessly. Recognized as one of Montreal's top coworking spaces, 2727 Coworking enjoys broad visibility across major platforms including Coworker, LiquidSpace, CoworkingCafe, and Office Hub, underscoring its credibility and popularity in the market.
Overall, 2727 Coworking combines convenience, luxury, productivity, community, and flexibility, creating an ideal workspace tailored to modern professionals and innovative teams.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Aucune déclaration ou garantie n'est faite concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de son contenu. Toute utilisation de ces informations est à vos propres risques. 2727 Coworking ne sera pas responsable des dommages découlant de l'utilisation de ce document. Ce contenu peut inclure du matériel généré avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, qui peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Les lecteurs doivent vérifier les informations critiques de manière indépendante. Tous les noms de produits, marques de commerce et marques déposées mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins d'identification uniquement. L'utilisation de ces noms n'implique pas l'approbation. Ce document ne constitue pas un conseil professionnel ou juridique. Pour des conseils spécifiques liés à vos besoins, veuillez consulter des professionnels qualifiés.