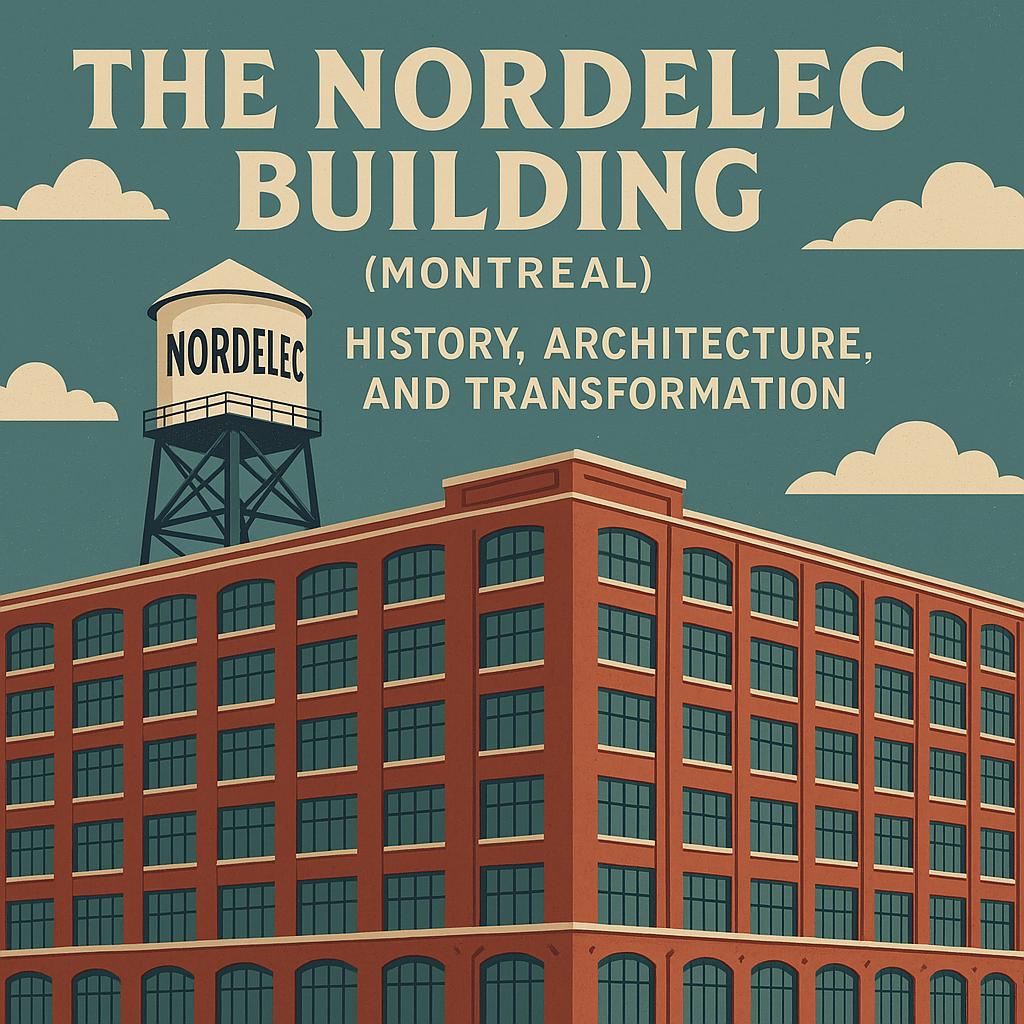
Bâtiment Nordelec (Montréal) : Histoire industrielle et architecture
Le bâtiment Nordelec (Montréal) – Histoire, Architecture et Transformation
Origines et Construction (1913–1914)
Le bâtiment Nordelec, initialement connu sous le nom d'usine de la Northern Electric Company Limited, fut conçu au début du XXe siècle comme une installation industrielle majeure pour l'industrie des télécommunications en pleine croissance au Canada. En 1912, Bell Canada (alors The Bell Telephone Company of Canada) avait dépassé la capacité de ses ateliers existants et cherchait un nouveau site à proximité du canal de Lachine et des lignes de chemin de fer – des infrastructures essentielles pour le transport de marchandises lourdes[1][2]. L'emplacement choisi à Pointe-Saint-Charles avait autrefois été occupé par un ancien bassin et une scierie, qui furent comblés pour accueillir le nouveau complexe massif[3]. La construction de l'usine commença en 1913 sous la direction de William John Carmichael (1867–1927), architecte en chef de Bell[4]. Les plans de Carmichael produisirent un bâtiment industriel en forme de E composé de quatre ailes initiales – deux de huit étages et deux de quatre étages – disposées en parallèle et orientées approximativement nord-sud[4]. Ces ailes étaient reliées par un corps central, formant la forme d'un « E » massif, avec des cours intérieures ouvertes entre les ailes pour laisser entrer la lumière et l'air. En 1914, avant même que le complexe ne soit entièrement achevé, la branche manufacturière de Bell fut restructurée : l'Imperial Wire and Cable Company (une filiale de Bell pour la fabrication de fils) fusionna avec la Northern Electric and Manufacturing Company pour former la Northern Electric Company[5]. Cette nouvelle entité consolida la fabrication d'appareils téléphoniques, de câbles et d'équipements électriques au sein d'une seule entreprise, et la vaste usine de Pointe-Saint-Charles devint son installation de production phare[5].
La conception du bâtiment Nordelec était avancée pour son époque et spécialement conçue pour la fabrication lourde. La structure fut conçue avec une ossature en acier et des fondations en béton armé, tandis que l'extérieur était revêtu de briques rouges[6]. Cette construction robuste était typique de l'architecture industrielle du début du XXe siècle, mettant l'accent sur la fonctionnalité, la résistance au feu et la capacité de supporter des machines lourdes à chaque étage. Des rangées de grandes fenêtres régulièrement espacées bordent les façades, inondant l'intérieur de lumière naturelle – une caractéristique du concept d'« usine à lumière du jour ». En effet, la composition en brique et acier du bâtiment illustre le style architectural industriel des années 1920, une période où les usines à plusieurs étages étaient construites pour maximiser la capacité de production[7]. Malgré cela, les architectes ne négligèrent pas entièrement l'esthétique : une ornementation subtile fut incluse à la ligne de toit. Notamment, le sommet des piliers verticaux en brique est décoré de motifs inspirés de l'Art Déco, ajoutant une touche de raffinement architectural à une façade autrement utilitaire[8].
Expansion et Apogée Industrielle (années 1920–1940)
Suite à sa construction initiale, le complexe Northern Electric subit de multiples agrandissements pour répondre à une demande croissante d'équipements de télécommunications. Les années 1920 furent une période de croissance intense. En 1926, l'une des ailes de quatre étages fut surélevée par l'ajout de quatre étages supplémentaires, la portant à huit étages comme les autres[9]. Deux ans plus tard, en 1928, une nouvelle structure d'un seul étage fut construite sur le site – probablement pour abriter des équipements spécialisés ou servir d'annexe pour le traitement des matériaux[9]. Ces ajouts des années 1920 furent conçus par Joseph-Omer Despatie, un architecte montréalais qui travailla beaucoup sur les installations de Northern Electric[10]. La plus grande expansion eut lieu en 1929, lorsque Northern Electric érigea une toute nouvelle aile de huit étages le long de la rue Richmond (aujourd'hui rue de la Sucrerie) et prolongea simultanément la section de faible hauteur le long de la rue Richardson[9][11]. Ce projet fut supervisé par J. S. Cameron de Northern Electric en collaboration avec l'ingénieur E. G. Patterson de la Foundation Company, qui optèrent pour une ossature métallique moderne sur une fondation en béton pour soutenir l'ajout massif[11]. Grâce à ces expansions, le complexe atteignit sa taille maximale au début des années 1930 – englobant cinq ailes interconnectées de 8 étages occupant un pâté de maisons entier. De grandes cours intérieures (construites au-dessus du rez-de-chaussée et surmontées de puits de lumière) se trouvaient entre les ailes, fournissant lumière et ventilation au cœur du bâtiment[8]. Au coin sud-ouest du complexe (rues St-Patrick et Shearer), un bâtiment séparé de deux étages en brique fut construit pour abriter la chaufferie et la centrale électrique, identifiable par sa large cheminée circulaire[12]. À côté se trouvaient des structures supplémentaires d'un et deux étages pour les quais de chargement et l'entreposage, complètes avec des portes surdimensionnées et des baies de chargement en béton armé pour permettre l'accès des wagons de marchandises[13]. En fait, l'usine était directement intégrée au réseau ferroviaire : une voie de garage intérieure pouvait accueillir jusqu'à 22 wagons de marchandises pour l'expédition et la réception de biens, illustrant la connexion transparente du site au réseau ferroviaire canadien[14].
À la fin des années 1920 et dans les années 1930, l'usine Northern Electric de Pointe-Saint-Charles était devenue l'un des plus grands et des plus importants complexes industriels de Montréal. On l'appelait souvent simplement l'usine de la rue Shearer (d'après l'une de ses rues adjacentes) et elle était un symbole de la puissance manufacturière de la ville[15][16]. L'installation produisait une vaste gamme de produits : dans les années 1930, elle fabriquait quelque 30 000 composants différents, des fils électriques isolés et câbles téléphoniques aux ensembles téléphoniques complets et aux appareils électroniques émergents[17]. Chaque catégorie de produit était fabriquée dans son propre département dédié au sein de l'usine, faisant essentiellement du complexe une ville industrielle autonome avec des ateliers spécialisés sous un même toit[17]. La complexité de la production était stupéfiante – on estimait que 15 000 matières premières différentes étaient nécessaires pour soutenir la fabrication de tous ces produits[18]. Cela incluait tout, du cuivre et du caoutchouc (pour le câblage et l'isolation) aux pièces électroniques délicates. Pour gérer la logistique, l'usine exploitait les deux principales lignes ferroviaires qui passaient à proximité : les chemins de fer Canadien Pacifique et Grand Tronc (plus tard Canadien National) avaient chacun des embranchements menant directement au dépôt de marchandises de l'usine, facilitant l'expédition efficace des produits finis à travers le Canada[19].
Pendant cette période d'apogée industrielle, le bâtiment Nordelec (comme il serait appelé plus tard) était un moteur d'activité économique. Il offrait des milliers d'emplois et contribua à consolider la position de Montréal en tant que centre de la fabrication d'équipements électriques et de télécommunications au Canada. L'emploi au complexe de Pointe-Saint-Charles augmenta considérablement dans les années 1930 et 1940. Les registres contemporains et les récits historiques ultérieurs varient quant aux chiffres exacts, mais tous s'accordent à dire que la main-d'œuvre était énorme. Selon un compte, l'usine employait jusqu'à 4 686 travailleurs dans les années 1940[17]. Cependant, les sources patrimoniales notent que ce chiffre continua de croître : 9 000 travailleurs étaient sur le site vers 1940[3], et des récits oraux parlent d'un pic de 12 000 employés au complexe lorsqu'il fonctionnait à pleine capacité[20]. Cela ferait de Northern Electric l'un des plus grands employeurs de Montréal au milieu du siècle, rivalisant avec les grandes usines des industries textiles et alimentaires de la ville. En effet, les groupes patrimoniaux locaux soulignent que Northern Electric « était l'un des plus grands employeurs de Pointe-Saint-Charles » à cette époque[3]. L'impact social fut considérable : des générations de résidents du quartier trouvèrent du travail à l'usine, et la communauté ouvrière environnante grandit et prospéra au gré de la fortune de l'usine.
Le complexe Northern Electric joua également un rôle important dans l'économie canadienne en temps de guerre et d'après-guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la main-d'œuvre qualifiée et les vastes installations de l'usine furent probablement réaffectées ou mises à profit pour la production de guerre (par exemple, la fabrication de dispositifs de communication pour l'armée), bien que les sources primaires se concentrent davantage sur sa production d'équipements téléphoniques en temps de paix. Dans l'immédiate après-guerre (fin des années 1940), la demande de téléphones et de biens électriques augmenta de nouveau, entraînant une dernière expansion physique du bâtiment. En 1948, l'entreprise ajouta un étage supplémentaire à l'une des structures – le point culminant de près de quatre décennies de croissance[6]. Après cet ajout, le bâtiment principal atteignit sa hauteur maximale de huit étages sur toute sa surface. À la fin des années 1940, le bâtiment Nordelec avait pris la forme qu'il conserve aujourd'hui, et il se dressait comme un colossal pôle manufacturier au cœur du sud-ouest industriel de Montréal[6].
Déclin d'Après-Guerre et Transition Industrielle (années 1950–1970)
Dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, le complexe Northern Electric fut progressivement confronté aux défis d'une industrie et d'un paysage urbain en évolution. Sur le plan technologique, le milieu du XXe siècle apporta des changements rapides : l'entreprise (renommée Northern Telecom en 1976, et plus tard connue sous le nom de Nortel) passa d'équipements téléphoniques purement électromécaniques à l'électronique avancée, y compris les premiers systèmes de communication numérique et par satellite[21]. L'ancienne usine de Pointe-Saint-Charles, avec son agencement à plusieurs étages et son infrastructure plus ancienne, devint moins adaptée aux nouveaux processus de fabrication. La production de nouvelles technologies favorisait souvent de vastes installations de plain-pied dans des emplacements suburbains ou périurbains, où la manutention des matériaux et l'assemblage pouvaient être plus facilement rationalisés. À partir des années 1960 et au début des années 1970, Northern Electric commença à délocaliser ses opérations de l'usine de la rue Shearer vers des usines plus modernes en périphérie de Montréal et ailleurs[22]. En 1974, l'entreprise avait complètement cessé la fabrication sur le site de Pointe-Saint-Charles[23][22]. Cela marqua la fin d'une ère : un complexe industriel qui avait autrefois bourdonné de milliers de travailleurs devint largement silencieux.
Des forces économiques plus larges accélérèrent également le déclin de l'installation. L'ensemble du district industriel du sud-ouest de Montréal connut un ralentissement au milieu du XXe siècle. L'ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959 détourna le trafic maritime du canal de Lachine, rendant le canal obsolète pour le commerce[24][25]. En conséquence, les usines le long du canal, y compris Northern Electric, perdirent un avantage logistique clé. Le canal fut fermé à la navigation en 1970 et la zone environnante entra dans un déclin économique[25]. De plus, les politiques de rénovation urbaine et les changements dans les transports (comme les nouvelles autoroutes) perturbèrent les anciens quartiers ouvriers. Au début des années 1970, Montréal connaissait une désindustrialisation, et la gigantesque usine de Pointe-Saint-Charles fut une victime de ce processus.
Cependant, le bâtiment Nordelec n'a pas été démoli – il a plutôt rapidement trouvé une nouvelle vocation grâce à la réutilisation adaptative. En 1975, à peine un an après le départ de Northern Electric, l'ensemble de la propriété a été vendu à un consortium privé qui l'a rebaptisée le Nordelec Industrial Plaza[22]. (Le nom « Nordelec » est lui-même un mot-valise faisant référence à Northern Electric.) L'objectif de ce groupe était de réaménager le site en un centre industriel et commercial multi-locataires[26][27]. Selon le concept du Nordelec Industrial Plaza, les vastes étages qui abritaient autrefois des chaînes de montage ont été divisés et loués à de petits fabricants, des entrepôts et diverses entreprises. Cette stratégie reflétait ce qui se passait dans d'autres villes, où de grandes usines vides étaient transformées en espaces abordables pour l'industrie légère ou le stockage. Pendant un certain temps, cette conversion a maintenu le complexe économiquement actif, bien qu'avec un profil plus bas que pendant son apogée. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, de petites entreprises et des startups occupaient des parties du bâtiment, et celui-ci conservait le caractère brut d'un espace de loft industriel.
La Ville de Montréal s'est également impliquée directement. La Société de développement de Montréal (SDM) – une agence de développement municipal – a acquis le complexe Nordelec à un certain moment (probablement dans les années 1980) avec la vision de favoriser un pôle de haute technologie à Pointe-Saint-Charles[28][29]. Le plan de la SDM était d'incuber de petites entreprises de haute technologie dans ce bâtiment historique, en tirant parti de ses vastes plateaux et de sa construction solide. En effet, l'idée d'un « Technoparc » ou d'un centre d'innovation dans une ancienne usine était avant-gardiste pour l'époque, anticipant la tendance ultérieure des entreprises technologiques à privilégier les lofts industriels réhabilités. Cependant, la modernisation complète d'une structure aussi vaste nécessitait des investissements substantiels. Manquant de fonds pour achever seule la réhabilitation, la SDM a finalement décidé de transférer la propriété au secteur privé[29][30].
En 2003, le complexe Nordelec a été acquis par Elad Canada, une société de développement immobilier (faisant partie du Groupe El-Ad) contrôlée par l'entrepreneur Yitzhak Tshuva[31][32]. Cette vente a marqué le début de la prochaine transformation majeure pour ce bâtiment chargé d'histoire. L'achat par Elad comprenait non seulement l'édifice principal de l'usine historique, mais aussi plusieurs lots adjacents autour de l'îlot urbain délimité par les rues Shearer, Saint-Patrick, de Condé et Richardson[33][34]. Le terrain était prêt pour un réaménagement ambitieux qui propulserait le Nordelec au 21e siècle avec une vocation entièrement nouvelle.
Réaménagement et réutilisation adaptative (années 2000 à aujourd'hui)
La vision d'Elad Canada pour le Nordelec était de convertir la propriété industrielle vieillissante en un complexe dynamique à usage mixte, mêlant fonctions résidentielles, commerciales et de bureaux. Ce plan coïncidait avec une tendance urbaine plus large : la revitalisation de l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal (qui comprend Pointe-Saint-Charles et Griffintown voisin) au début des années 2000. Après la réouverture du canal de Lachine en 2002 en tant que voie navigable récréative et parc linéaire, le front de mer industriel autrefois dégradé a commencé à attirer un nouvel intérêt pour le développement immobilier[35][36]. La ville, pour sa part, encourageait le réaménagement à usage mixte dans la région, espérant redonner vie aux usines longtemps inactives tout en répondant aux besoins en logement. Notamment, en 2005, Montréal a adopté une Stratégie d'inclusion de logements abordables, une politique exigeant que les grands nouveaux développements intègrent un pourcentage d'unités de logement social et abordable[37][38]. Le projet Nordelec est devenu un cas d'étude pour cette politique à Pointe-Saint-Charles, un quartier connu pour son fort activisme communautaire et sa méfiance à l'égard de la gentrification[38][39].
Elad a procédé méthodiquement. En 2005, le promoteur a présenté publiquement sa proposition de rezoner le site du Nordelec d'un usage purement industriel à un secteur « à usage mixte », ce qui permettrait des usages résidentiels aux côtés de bureaux et de commerces de détail[40][41]. Cela nécessitait une modification du plan d'urbanisme de la ville, et un vaste processus de consultation publique s'en est suivi sous l'égide de l'Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM). Le plan directeur initial, élaboré avec le cabinet d'architectes Cardinal Hardy (ultérieurement fusionné avec Lemay), envisageait un mini-quartier intégré sur les terrains du Nordelec[42]. Selon le plan, le bâtiment historique de l'usine de 8 étages serait conservé et rénové, ses énormes espaces intérieurs étant convertis en bureaux de style loft à certains étages et en condominiums à d'autres. Le projet englobait cinq parcelles de terrain contiguës totalisant 44 000 m², dont environ la moitié était alors occupée par des stationnements de surface et des zones de chargement offrant de l'espace pour de nouvelles constructions[33][43]. Elad a proposé de construire des structures de moyenne hauteur supplémentaires sur ces lots, y compris plusieurs nouvelles ailes de condominiums et éventuellement une tour, ajoutant ainsi une nouvelle densité résidentielle tout en respectant le tissu patrimonial du bâtiment principal. Le plan de réaménagement prévoyait environ 1 300 unités résidentielles au total et une surface commerciale significative[44][45]. Dans un rapport d'ingénierie ultérieur, la répartition était d'environ 75 000 m² de bureaux, 7 000 m² de commerces de détail et 1 300 unités résidentielles, le tout intégré sur le site[44][46]. La conception prévoyait également un stationnement substantiel (plus de 1 500 places de stationnement souterraines) et des commodités pour les locataires[47][48].
L'apport de la communauté a été un facteur critique lors de la planification. Les résidents et organisations locales, fiers du patrimoine industriel de leur quartier et préoccupés par le déplacement, ont insisté pour que le projet inclue des logements abordables et préserve le « tissu social » de Pointe-Saint-Charles[49][50]. En conséquence, le réaménagement du Nordelec par Elad est devenu le premier grand projet à Montréal à mettre en œuvre la nouvelle stratégie d'inclusion de logements de la ville. Environ 30 % des nouvelles unités de logement ont été désignées comme logements hors marché – réparties entre 15 % de logements abordables/communautaires et 15 % de logements subventionnés/sociaux – garantissant qu'une partie des nouveaux condos resterait accessible aux familles à faible revenu[51][52]. L'inclusion d'unités abordables, ainsi que d'autres concessions (telles que la préservation de certains emplois existants sur le site et l'échelonnement progressif du projet), ont contribué à obtenir le soutien de la communauté. En 2007, l'OCPM a donné son approbation aux changements de zonage nécessaires, et le réaménagement du Nordelec a pu se poursuivre.
Les travaux de construction et de conversion ont eu lieu principalement entre 2010 et 2015. La préservation du patrimoine était un principe directeur : à l'extérieur, les façades historiques en briques du bâtiment et son caractère industriel distinctif ont été maintenus. « L'entreprise a investi énormément d'argent pour restaurer et maintenir sa façade d'origine tout en modernisant tous les systèmes du bâtiment », a noté un rapport immobilier commercial en 2016[53][54]. À l'intérieur, les espaces ont été mis à jour selon les normes contemporaines. La structure, ayant été construite par phases bien avant les codes du bâtiment modernes, a nécessité d'importantes améliorations en matière de sécurité et de performance – par exemple, le renforcement de la charpente pour la résistance sismique et l'installation de nouveaux ascenseurs et systèmes de CVC[55][44]. Les consultants en ingénierie (tels que NCK, qui a géré l'ingénierie structurelle) ont méticuleusement vérifié les anciennes colonnes et poutres, étant donné que la construction originale précédait le premier Code national du bâtiment de 1941[55][45]. De nouveaux éléments ont été ajoutés, comme des cours intérieures dotées de toits en verre, et les anciennes cours ont été réaménagées en atriums et en espaces communs reliant différentes ailes. Un élément de conception notable a été la réaffectation de l'ancienne chaufferie : cet espace volumineux, avec ses hauts plafonds et ses briques apparentes, a été converti en un spectaculaire centre de vente et loft modèle pour le projet de condominium – un design qui a même remporté un Grand Prix du Design local pour son mélange innovant d'éléments historiques et modernes (Source: int.design(Source: int.design.
Figure 1 : La longue façade en briques du Nordelec (8 étages) illustre l'architecture industrielle du début du 20e siècle, avec de grandes fenêtres répétitives et de subtils détails Art Déco au sommet des piliers verticaux[8]. La construction à ossature d'acier du bâtiment et ses vastes plateaux ouverts ont permis sa conversion en bureaux modernes et en appartements de type loft. En 2015, le Nordelec avait en grande partie achevé sa renaissance en tant que complexe à usage mixte. Le résultat est un mélange d'ancien et de nouveau : des bureaux de style loft (avec de hauts plafonds, des briques apparentes et des poutres) occupent une partie substantielle des étages, tandis que des résidences en copropriété remplissent d'autres parties de l'ancienne usine et des ailes adjacentes nouvellement construites[56][57]. Le rez-de-chaussée le long de la rue Saint-Patrick a été aménagé avec des espaces commerciaux, y compris des cafés, des services et une épicerie spécialisée, pour servir à la fois les résidents et les travailleurs[58][59]. Au milieu des années 2010, plus de 2 300 personnes vivent ou travaillent quotidiennement au sein de la propriété Nordelec[60][61] – une population comparable à celle d'un petit village, animant un site qui, quelques décennies plus tôt, était presque à l'abandon. Le complexe réalise désormais véritablement un environnement « vivre-travailler-se divertir ». Il est même devenu une sorte de pôle technologique et d'industries créatives : les locataires de la partie bureaux comprennent des entreprises de logiciels, des studios de design et des succursales de sociétés technologiques telles qu'Uber, GSoft, Softchoice et d'autres[62][63]. L'afflux de ces entreprises innovantes rappelle l'idée antérieure de la SDM d'un centre de haute technologie, désormais réalisé organiquement grâce au réaménagement privé. Avec un taux d'occupation des bureaux d'environ 70 % et une forte demande pour les bureaux uniques en briques et poutres, le projet est considéré comme un succès commercial[64]. En 2016, les propriétaires ont mis en vente la composante bureaux et commerces de détail du Nordelec, la présentant comme « l'un des plus grands immeubles de bureaux en briques et poutres en Amérique du Nord », une opportunité d'investissement emblématique unique[65][57]. (Les condos résidentiels restent la propriété individuelle de leurs propriétaires et sont gérés par une association de copropriétaires.) Cette affirmation souligne l'échelle physique exceptionnelle du complexe, même après son réaménagement.
D'un point de vue urbanistique, la transformation du Nordelec a été présentée comme un modèle de réaménagement intégré. Elle a réussi à introduire une grande communauté résidentielle dans un ancien quartier industriel tout en préservant l'emploi sur place – s'alignant sur l'objectif de la ville de diversification des usages mixtes. Fait important, le réaménagement a été réalisé de manière à préserver l'architecture patrimoniale. Plutôt que de démolir la structure massive (ce qui aurait pu être le sort d'une si vieille usine), les promoteurs et la communauté ont choisi la réutilisation adaptative, maintenant un lien visuel et matériel avec le passé industriel de Montréal. Le projet a également eu des retombées : il a contribué à stimuler l'amélioration du paysage urbain environnant et à la revitalisation plus large de Pointe-Saint-Charles. Aujourd'hui, les berges du canal de Lachine près du Nordelec sont bordées de pistes cyclables, de parcs et d'autres bâtiments de type loft convertis, alors que l'ensemble du quartier passe de ses racines industrielles brutes à un quartier urbain mixte et branché. Pourtant, la taille imposante et la présence historique du Nordelec ancrent l'identité du quartier au milieu de tous ces changements.
Style et caractéristiques architecturales
Architecturalement, le bâtiment Nordelec est un exemple remarquable du patrimoine industriel montréalais du début du XXe siècle. Son style peut être classé comme moderne industriel avec quelques influences Art Déco dans ses détails. Comme décrit précédemment, le complexe a été construit principalement entre 1913 et 1929 (avec un ajout final en 1948) en utilisant une grille structurelle de colonnes et de poutres en acier, ce qui a permis des planchers intérieurs vastes et ouverts. L'extérieur est composé de briques rouge-brun posées sur une solide base en calcaire avec des pierres rustiquées au rez-de-chaussée[66][8]. Ce revêtement de maçonnerie a conféré à l'usine une durabilité mais aussi une esthétique imposante et unifiée. Les baies vitrées répétitives – de grandes fenêtres à carreaux multiples alignées en longues rangées horizontales – ont été conçues pour maximiser la lumière du jour pour les travailleurs à l'intérieur, une caractéristique importante à l'époque précédant l'éclairage moderne des usines. Chaque baie vitrée est séparée par des piliers de brique (colonnes verticales de maçonnerie), et au sommet de ces piliers, on peut encore voir des motifs géométriques d'inspiration Art Déco qui ornent la ligne de la corniche[8]. Ces fioritures décoratives (probablement ajoutées lors des extensions de la fin des années 1920, lorsque l'Art Déco était en vogue) comprennent des motifs floraux ou en zigzag stylisés en brique et en terre cuite, conférant à la façade autrement utilitaire une touche d'élégance. L'impression générale des façades principales – comme le long des rues Richardson ou Saint-Patrick – est celle d'une répétition rythmique et d'une échelle monumentale, digne d'une usine qui fut autrefois parmi les plus grandes du Canada.
En plan, la forme originale en « E » du bâtiment et les ajouts ultérieurs ont donné lieu à un agencement complexe qui occupe un bloc entier. Les cinq ailes principales sont parallèles les unes aux autres, avec des puits de lumière étroits entre elles. Ces espaces ont été habilement traités comme des cours intérieures construites au-dessus du premier étage, créant ainsi des atriums intérieurs avec puits de lumière afin que même le deuxième étage et les étages supérieurs puissent recevoir la lumière du soleil des deux côtés[8]. L'aile perpendiculaire le long de la rue Richardson a fermé le « E » pour former un quadrilatère, tout en laissant un espace de cour ouvert au sud. Cette configuration a équilibré le besoin de surface au sol maximale avec le besoin de lumière naturelle et de circulation d'air à une époque précédant la climatisation. À l'intérieur, les planchers ont été conçus pour supporter de lourdes charges – des ensembles denses de machines de travail des métaux, de bobines de câbles et de chaînes de montage. Des photographies du milieu du XXe siècle montrent de vastes ateliers avec des rangées de femmes et d'hommes assemblant des centraux téléphoniques et enroulant des bobines, éclairés par la lumière du jour provenant de ces hautes fenêtres (complétée par des lampes néon suspendues dans les années ultérieures).
Figure 2 : Photographie d'archives d'ouvriers de l'usine Northern Electric (vers les années 1910-1920) devant l'usine de Pointe-Saint-Charles. Les solides murs de briques et une voie ferrée interne (visible au premier plan) illustrent la conception industrielle du bâtiment. À son apogée, cette installation employait des milliers de Montréalais[20]. Une structure annexe remarquable du complexe est la centrale électrique au coin des rues Saint-Patrick et Shearer. Ce bâtiment en brique de deux étages, contemporain de la structure principale, abritait des chaudières et des générateurs électriques pour alimenter les besoins en énergie de l'usine[12]. Sa grande cheminée (une cheminée circulaire en brique, aujourd'hui tronquée) est une caractéristique emblématique visible sur les photos historiques – un symbole de l'époque où les usines produisaient leur propre vapeur et électricité. La façade de la centrale électrique présente le même style de brique et même les motifs décoratifs que le bâtiment principal, créant un ensemble cohérent[67]. À côté, le long de la rue Shearer, se trouve une aile d'un seul étage qui était utilisée pour l'expédition et la réception, avec plusieurs portes de quai de chargement dotées de linteaux en béton pour le chargement par camion et par rail[68]. Ces sections d'un étage sont de conception utilitaire, mais leur maçonnerie comprend des motifs en forme de losange et d'autres maçonneries décoratives, reflétant à nouveau une attention aux détails même dans les zones de service[69]. Les entrées principales du complexe Nordelec – à l'origine sur Richardson et Saint-Patrick – ont été traitées avec dignité : elles présentent des encadrements de porte en pierre sculptée et des frontons portant le nom ou le logo de l'entreprise, signifiant l'importance de l'installation[70]. Certains de ces éléments patrimoniaux ont été préservés ou restaurés dans le complexe à usage mixte actuel, souvent mis en valeur comme des « fossiles » architecturaux qui relient les nouveaux occupants à l'histoire du site (par exemple, le promoteur a intégré des photographies et des artefacts historiques dans la conception du hall pour célébrer le passé du bâtiment (Source: int.design(Source: int.design).
Dans l'ensemble, les architectes et les historiens considèrent le bâtiment Nordelec comme un exemple remarquable de l'architecture industrielle du début du XXe siècle à Montréal(Source: int.design. Il combine une conception pragmatique – une usine sans fioritures optimisée pour la fabrication – avec des détails architecturaux subtils et une présence urbaine imposante. Par son échelle et son époque, il est comparable à d'autres géants industriels nord-américains comme l'usine Ford Highland Park à Detroit ou la Sunlight Soap Works à Toronto. Pourtant, le Nordelec a son propre caractère montréalais, notamment parce qu'il incarne physiquement l'histoire de l'essor de la ville en tant que centre de fabrication de télécommunications. L'architecture du bâtiment a donc une valeur patrimoniale non seulement pour son style, mais pour ce qu'elle représente en termes de forme industrielle au service de la fonction. Comme l'a noté Héritage Montréal, la masse même de la structure « reflète l'image d'une époque de secteurs industriels denses » dans la ville[71][72]. Cette fusion d'authenticité historique et de réutilisation contemporaine est un aspect clé de l'attrait architectural durable du Nordelec.
Rôle industriel et économique à Montréal et au Canada
Au cours de sa vie opérationnelle, l'usine Nordelec (Northern Electric) a joué un rôle industriel et économique central à plusieurs niveaux : le quartier, la ville de Montréal et le secteur technologique canadien dans son ensemble. Localement, dans les quartiers de Pointe-Saint-Charles et de Griffintown adjacents, Northern Electric était plus qu'un simple lieu de travail – c'était un pilier communautaire. À son apogée dans les années 1940, comme mentionné, des milliers de familles de la région comptaient au moins un membre employé à « la Northern » (comme on l'appelait familièrement)[3]. La présence de l'usine a stimulé le développement de logements ouvriers, de magasins et de services à proximité. Par exemple, l'entreprise a construit des commodités pour les employés, telles qu'une cafétéria, et a organisé des clubs sociaux, et les emplois stables ont aidé de nombreux Montréalais de la classe ouvrière à atteindre une prospérité modeste. Des récits oraux du quartier rappellent le « sifflet du dîner » qui marquait la pause de midi, lorsque des flots d'ouvriers se déversaient dans les rues Shearer et Richardson – un rythme quotidien qui définissait la vie dans le Point. La sécurité économique procurée par les emplois de Northern Electric (qui allaient des fabricants d'instruments de précision qualifiés aux postes de chaîne de montage) a eu des effets intergénérationnels. En effet, la perte de ces emplois dans les années 1970 a été un coup dur pour la communauté, contribuant à une période de difficultés. Ce contexte explique pourquoi les résidents actuels ont un fort attachement émotionnel au bâtiment et pourquoi ils ont plaidé pour un réaménagement qui respecte le patrimoine ouvrier du quartier[50][73].
Au niveau de la ville, Montréal dans la première moitié du XXe siècle était la capitale industrielle du Canada, et le complexe Northern Electric était l'un des fleurons de sa base manufacturière. La croissance économique de la ville était étroitement liée à l'expansion industrielle le long du canal de Lachine, et Northern Electric se distinguait même parmi les géants. En 1940, elle était citée comme le plus grand employeur de tout le secteur sud-ouest de Montréal[3]. Le succès de l'usine a également soutenu la position de Montréal dans l'industrie des télécommunications. Northern Electric était le bras manufacturier de l'expansion du réseau de Bell Canada ; pratiquement chaque téléphone installé dans les foyers et les entreprises canadiens au milieu du siècle contenait probablement des composants fabriqués à l'usine de Pointe-Saint-Charles. L'usine produisait également des biens d'exportation et exécutait des contrats gouvernementaux, contribuant ainsi à l'économie d'exportation de Montréal. Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre, la production de Northern Electric a soutenu la construction d'infrastructures critiques (comme les centraux téléphoniques) à travers le pays. Dans un sens plus large, le bâtiment Nordelec est culturellement significatif pour Montréal en tant que symbole de la transition de la ville de l'ère victorienne du fer et du rail à l'ère moderne de l'électronique et de la communication.
Au niveau national, Northern Electric (qui a ensuite évolué pour devenir Nortel Networks) est passée de ces racines montréalaises à un géant mondial des télécommunications. L'usine de Pointe-Saint-Charles a été le principal centre de production de l'entreprise de 1914 jusqu'aux années 1970, servant essentiellement d'épine dorsale matérielle du système téléphonique canadien pendant plus d'un demi-siècle[21]. Les innovations et l'expertise qualifiée développées ici ont eu un impact considérable. Par exemple, les ingénieurs de Northern Electric à Montréal ont contribué au développement de nouvelles technologies de commutation téléphonique et, dans les années 1960, travaillaient sur des projets de pointe comme l'équipement de communication par satellite[21]. Le rôle économique de l'usine de Montréal peut également être considéré dans le contexte de la politique industrielle canadienne : c'était l'une des plus grandes opérations de fabrication canadiennes dans le secteur de la haute technologie à l'époque, contribuant à réduire la dépendance à l'égard des équipements importés. Sa fermeture progressive dans les années 1970 a coïncidé avec un changement, alors que Northern Telecom ouvrait de nouvelles usines ailleurs (comme en Ontario et plus tard en Alberta), mais l'héritage de l'installation de Montréal a perduré grâce à l'expertise et aux travailleurs qualifiés qu'elle a produits. De nombreux employés qui ont commencé sur le site de Pointe-Saint-Charles ont ensuite travaillé dans d'autres installations de Nortel ou dans des industries technologiques connexes, semant les graines de la main-d'œuvre technologique du Canada.
En résumé, le rôle industriel du bâtiment Nordelec a été fondamental – il a été un pivot de l'économie industrielle de Montréal et un contributeur clé à l'infrastructure de télécommunications du Canada[15][16]. Son histoire reflète le récit plus large de l'industrialisation, de la croissance maximale et de la désindustrialisation éventuelle vécues par tant de villes nord-américaines. Le fait que le bâtiment soit toujours debout, maintenant rempli de nouvelles activités économiques, ajoute un chapitre rare de continuité à ce récit. Peu de sites industriels de cette ampleur ont réussi à passer à la nouvelle économie tout en conservant leur tissu historique. Le Nordelec est donc un cas illustratif de la façon dont un site de grande importance économique à une époque peut renaître pour jouer un rôle économique très différent à une autre – dans ce cas, passant de la fabrication de matériel à l'incubation de logiciels et de services créatifs au XXIe siècle[62][63].
Importance culturelle et historique
Le bâtiment Nordelec occupe une place distinguée dans la mémoire culturelle et le patrimoine de Montréal. Au-delà de sa simple présence physique en tant que repère architectural, il représente les histoires humaines de travail, de communauté et d'innovation qui se sont déroulées entre ses murs. Pour la communauté patrimoniale de la ville, le Nordelec est considéré comme un artefact irremplaçable de l'ère industrielle. Il est inscrit au Répertoire du Patrimoine Culturel du Québec en tant que bien patrimonial industriel important, reconnu pour sa valeur historique et architecturale[74][75]. Bien qu'il ne soit pas un monument historique classé au plus haut niveau, il est officiellement documenté et « inventorié » dans le cadre du patrimoine de la région, ce qui signifie que toute modification est soumise à des considérations patrimoniales[76][77]. L'inscription met en lumière non seulement l'âge et l'architecture du bâtiment, mais aussi son rôle dans le récit de la technologie au Canada – des téléphones à l'électronique – et son incarnation de l'époque où Montréal était l'atelier industriel du pays[17][21].
Pour le quartier de Pointe-Saint-Charles, plus spécifiquement, le Nordelec est une source de fierté et d'identité collectives. Les sociétés historiques locales racontent fréquemment comment cette immense usine a « sué sang et eau » à travers des générations de travailleurs qui ont « bâti ce quartier »[78][50]. La survie et l'adaptation du bâtiment sont considérées comme une victoire pour la préservation du patrimoine dans une ville qui a parfois été trop prompte à démolir son passé industriel. La conservation du Nordelec a permis à l'histoire des ouvriers de Pointe-Saint-Charles de rester visible dans le paysage urbain. Lors des réunions communautaires sur le réaménagement, les citoyens ont insisté sur le fait que « le changement de notre milieu de vie ne doit pas se faire au détriment du tissu social actuel de notre quartier »[50]. En réponse, des éléments de l'histoire du bâtiment ont été consciemment intégrés dans sa nouvelle utilisation : par exemple, les promoteurs ont organisé des expositions de photos historiques dans le hall et ont conservé la signalisation extérieure d'origine du bâtiment. Le complexe a même été surnommé un « village vertical » car il mélange désormais divers résidents et travailleurs, reflétant en quelque sorte la communauté mixte d'autrefois mais sous une forme moderne[60][79].
Du point de vue du patrimoine culturel, le Nordelec sert également de lien physique avec des thèmes historiques clés de Montréal : la croissance du corridor industriel du canal de Lachine, l'essor des quartiers ouvriers et l'évolution de la technologie des télécommunications. Il se dresse aux côtés d'autres monuments industriels survivants comme la raffinerie de sucre Redpath (1854) et la filature de soie Belding-Corticelli (1884), faisant partie du paysage historique du Sud-Ouest[22][80]. En fait, la masse et l'échelle du Nordelec sont souvent citées comme emblématiques d'une époque – une époque où le sud-ouest de Montréal était rempli de « complexes imposants » symbolisant la puissance industrielle de la ville[71]. Les défenseurs du patrimoine soutiennent que la préservation de tels bâtiments est une responsabilité partagée, car ils constituent des liens tangibles avec le passé collectif de la ville[22][81]. La revitalisation réussie du Nordelec montre comment ces liens peuvent être maintenus tout en permettant l'écriture d'un nouveau chapitre.
En conclusion, l'histoire du bâtiment Nordelec s'étend sur plus d'un siècle d'évolution de Montréal. De son parcours chronologique – commençant comme une usine Bell Telephone en 1913, s'étendant pendant les années de boom, subissant un déclin, et finalement renaissant comme un complexe polyvalent moderne – nous pouvons retracer des schémas plus larges de changement économique et urbain. Son histoire architecturale est celle d'un design industriel fonctionnel qui a perduré grâce à une réutilisation adaptative. Son rôle industriel souligne l'importance de la fabrication et, plus tard, le passage à une économie du savoir à Montréal. Les événements clés de sa vie (fusions, expansions, production de guerre, fermeture, activisme communautaire, réaménagement) marquent chacun des tournants significatifs, non seulement pour le bâtiment mais aussi pour la ville qui l'entoure. Et dans son réaménagement, le Nordelec a trouvé une nouvelle pertinence, contribuant au renouvellement urbain et offrant une étude de cas sur l'équilibre entre le développement, le patrimoine et les besoins communautaires[40][41]. Culturellement, il se dresse comme un monument aux travailleurs et aux innovateurs de Montréal – une immense archive de briques de d'innombrables récits personnels et technologiques. La préservation et la reconversion du Nordelec démontrent comment une ville peut honorer son passé tout en forgeant son avenir, faisant de ce bâtiment une véritable pierre angulaire historique du tissu urbain de Montréal.
Références (Sources archivistiques et universitaires) :
-
Répertoire du Patrimoine Culturel du Québec – Usine Northern Electric Company Limited (Nordelec) : description historique et architecturale détaillée[74][82][83][17][21].
-
UQAM Chronologie de Montréal – Immeuble Northern Electric (1913) : confirme la date de construction, l'architecte et la conversion ultérieure en Nordelec[84][85].
-
Héritage Montréal / QAHN – Sentier du patrimoine Griffintown & Pointe-Saint-Charles : contextualise l'importance industrielle du Nordelec et l'emploi (9 000 travailleurs en 1940)[3].
-
Observatoire Ivanhoé Cambridge (Université de Montréal) – Étude de cas sur le réaménagement du Nordelec : fournit le calendrier du réaménagement, les détails de la consultation publique et du logement abordable[28][31][33][86][47].
-
NCK Ingénieurs-Conseils – Note de projet sur Le Nordelec : note les phases de construction originales (1913–1948), l'agencement du bâtiment (cinq ailes de 8 étages, cours) et l'étendue de la réhabilitation structurelle[45][46].
-
RENX (Real Estate News Exchange) – « Le Nordelec, le plus grand immeuble en brique et poutres de Montréal, à vendre » (25 février 2016 par Steve McLean) : compte rendu contemporain de la taille du bâtiment (790 000 pi²), de ses usages mixtes, de la composition des locataires (entreprises technologiques) et résumé historique[65][60][62].
-
INT Design Magazine – Projet de condo modèle Nordelec : remarques sur le bâtiment en tant qu'exemple notable d'architecture industrielle du début du XXe siècle et de réutilisation intérieure innovante (Source: int.design(Source: int.design.
-
OCPM (Office de Consultation Publique de Montréal) – Rapport de consultation publique sur le Nordelec (2007) : perspective communautaire sur la valeur patrimoniale et l'intégration de logements abordables[87][51].
-
« Montréal – Quelle histoire ! » (Histoire de Montréal) – photo d'archive et légende : emploi maximal de jusqu'à 12 000 personnes à l'usine de Pointe-Saint-Charles[20].
-
Des références archivistiques supplémentaires dans Les Innovateurs (bulletin d'entreprise de Northern Electric, 1974–75) et Northern Electric Northern News (journal d'entreprise, 1927–1930) documentent les expansions et les opérations du bâtiment[88][89]. Ces sources primaires (citées dans le registre du patrimoine) fournissent des détails de première main sur la construction et la fabrication au Nordelec pendant ses années fastes.
Sources externes
À propos de 2727 Coworking
2727 Coworking is a vibrant and thoughtfully designed workspace ideally situated along the picturesque Lachine Canal in Montreal's trendy Griffintown neighborhood. Just steps away from the renowned Atwater Market, members can enjoy scenic canal views and relaxing green-space walks during their breaks.
Accessibility is excellent, boasting an impressive 88 Walk Score, 83 Transit Score, and a perfect 96 Bike Score, making it a "Biker's Paradise". The location is further enhanced by being just 100 meters from the Charlevoix metro station, ensuring a quick, convenient, and weather-proof commute for members and their clients.
The workspace is designed with flexibility and productivity in mind, offering 24/7 secure access—perfect for global teams and night owls. Connectivity is top-tier, with gigabit fibre internet providing fast, low-latency connections ideal for developers, streamers, and virtual meetings. Members can choose from a versatile workspace menu tailored to various budgets, ranging from hot-desks at $300 to dedicated desks at $450 and private offices accommodating 1–10 people priced from $600 to $3,000+. Day passes are competitively priced at $40.
2727 Coworking goes beyond standard offerings by including access to a fully-equipped, 9-seat conference room at no additional charge. Privacy needs are met with dedicated phone booths, while ergonomically designed offices featuring floor-to-ceiling windows, natural wood accents, and abundant greenery foster wellness and productivity.
Amenities abound, including a fully-stocked kitchen with unlimited specialty coffee, tea, and filtered water. Cyclists, runners, and fitness enthusiasts benefit from on-site showers and bike racks, encouraging an eco-conscious commute and active lifestyle. The pet-friendly policy warmly welcomes furry companions, adding to the inclusive and vibrant community atmosphere.
Members enjoy additional perks like outdoor terraces and easy access to canal parks, ideal for mindfulness breaks or casual meetings. Dedicated lockers, mailbox services, comprehensive printing and scanning facilities, and a variety of office supplies and AV gear ensure convenience and efficiency. Safety and security are prioritized through barrier-free access, CCTV surveillance, alarm systems, regular disinfection protocols, and after-hours security.
The workspace boasts exceptional customer satisfaction, reflected in its stellar ratings—5.0/5 on Coworker, 4.9/5 on Google, and 4.7/5 on LiquidSpace—alongside glowing testimonials praising its calm environment, immaculate cleanliness, ergonomic furniture, and attentive staff. The bilingual environment further complements Montreal's cosmopolitan business landscape.
Networking is organically encouraged through an open-concept design, regular community events, and informal networking opportunities in shared spaces and a sun-drenched lounge area facing the canal. Additionally, the building hosts a retail café and provides convenient proximity to gourmet eats at Atwater Market and recreational activities such as kayaking along the stunning canal boardwalk.
Flexible month-to-month terms and transparent online booking streamline scalability for growing startups, with suites available for up to 12 desks to accommodate future expansion effortlessly. Recognized as one of Montreal's top coworking spaces, 2727 Coworking enjoys broad visibility across major platforms including Coworker, LiquidSpace, CoworkingCafe, and Office Hub, underscoring its credibility and popularity in the market.
Overall, 2727 Coworking combines convenience, luxury, productivity, community, and flexibility, creating an ideal workspace tailored to modern professionals and innovative teams.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Aucune déclaration ou garantie n'est faite concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de son contenu. Toute utilisation de ces informations est à vos propres risques. 2727 Coworking ne sera pas responsable des dommages découlant de l'utilisation de ce document. Ce contenu peut inclure du matériel généré avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, qui peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Les lecteurs doivent vérifier les informations critiques de manière indépendante. Tous les noms de produits, marques de commerce et marques déposées mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins d'identification uniquement. L'utilisation de ces noms n'implique pas l'approbation. Ce document ne constitue pas un conseil professionnel ou juridique. Pour des conseils spécifiques liés à vos besoins, veuillez consulter des professionnels qualifiés.
